Défense et illustration de la novlangue française
Jaime Semprun
Défense et illustration de la novlangue française
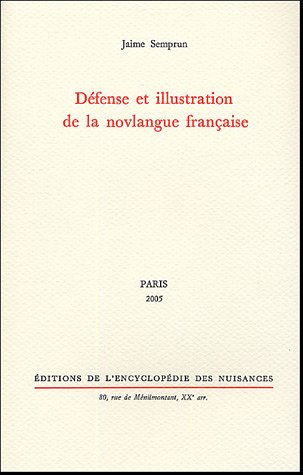
Acheter ce livre
(références en bas de page)
| Jaime Semprun Défense et illustration de la novlangue française PARIS 2005 ISBN 2-910386-22-8 ÉDITIONS DE L'ENCYCLOPÉDIE DES NUISANCES 80, rue de Ménilmontant, XX° arr. Ce petit livre ou pamphlet est difficile à cerner. Sous les traits d’un exposé très érudit il fait mine de défendre la nouvelle langue d’aujourd’hui appelée « novlangue ». Cette dernière serait une langue parfaite pour notre monde actuel basé sur la technique et les machines, donc sur le concret et l’objectif. L’ancienne langue appelée « archéolangue » est une pièce de musée sans avenir et incapable de s’adapter aux exigences de notre monde ! Pourtant sans connaître l’auteur (fils de Jorge Semprun) il me semble qu’il faut interpréter ce livre au second degré, je m’explique : Premièrement cet essai est écrit en « archéolangue » ce qui est contraire à son dessein. Deuxièmement quelques passages censés défendre la « novlangue » sont plutôt à interpréter comme des critiques du monde et du langage actuels. Troisièmement certains
raisonnements poussés à l’extrême sont là non
pour défendre mais au contraire pour monter l’artificialité
contemporaine. Enfin la conclusion qui fait aussi office de présentoir sonne comme un aveu : « Cependant, l'ayant défendue en tant qu'elle est la plus adéquate au monde que nous nous sommes fait, je ne saurais interdire au lecteur de conclure que c'est à celui-ci qu'il lui faut s'en prendre si elle ne lui donne pas entière satisfaction. » La « novlangue » serait donc une langue assujettie aux technologies, sans caractère, neutre, générale, sans subtilité, sans histoire, utilitaire avec pour seul but la « communication » immédiate sans artifice ! Pour vous faire un début d'idée lisez les extraits ci-dessous TABLE DES MATIÈRES Préface 9 I. Que la novlangue se constitue par la destruction de tout ce qui n'est pas elle. 11 II. S'il existe dans l'archéolangue une force de conservation propre à empêcher l'instauration de la novlangue. 15 III. En quoi la novlangue peut être dite la langue parfaite dont a si longtemps rêvé l'humanité. 18 IV. Des néologismes. 22 V. En quoi la novlangue parachève notre démocratie moderne. 31 VI. En quoi la novlangue réalise le programme des Lumières et de la Révolution française. 34 VII. Comment la linguistique scientifique a contribué à la formation de la novlangue. 41 VIII. Que la novlangue s'impose quand les machines communiquent. 46 IX. De la traduction. 58 X. S'il manque à la novlangue un poète qui sache l'illustrer comme Dante le fit pour la langue vulgaire de son temps. 62 XI. Réponse à diverses objections. 66 XII. Génie de la novlangue française. 86 XIII. Exhortation à délivrer le monde des archéolangues.88
Extraits : les chapeaux en italiques des extraits ont été rajoutés
politiquement correct le politiquement correct, terme qui lui-même constitue un néologisme de cette espèce, puisqu'il désigne ce à quoi on aurait précédemment donné le nom d'euphémisme : « figure par laquelle on déguise des idées désagréables, odieuses ou tristes, sous des noms qui ne sont point les noms propres de ces idées » et qui «leur servent comme de voiles », ainsi que l'écrit Dumarsais.
ordinateurs Ainsi, encore balbutiante, a-t-elle désigné tout d'abord par le nom quelque peu rustique de calculateurs ou calculatrices électroniques ces machines qu'elle a par la suite, renonçant à cette première dénomination à la fois malcommode et imprécise, préféré baptiser ordinateurs, terme qui assurément convient mieux à leur fonction principale de mettre de l'ordre dans la confusion de l'archéovie ; et qui a en outre, pour les trop rares lettrés sensibles aux beautés de la novlangue, une connotation quasi liturgique qui n'est pas ici sans pertinence.
comptabilité créative Moi-même ayant lu, appliquée à une longue suite de malversations couronnées par une banqueroute frauduleuse, l'expression comptabilité créative, j'avoue avoir tout d'abord souri, avant de m'aviser qu'il n'y avait pas de quoi. Parler de créativité est particulièrement bien venu quand il s'agit de la finance moderne, puisque d'une part aucun terme ancien de la langue propre aux comptables ne convient pour désigner les opérations qui donnent aujourd'hui aux acteurs de la nouvelle économie l'occasion d'enrichissements ou de ruines retentissantes, et puisque d'autre part nul ne saurait se dérober, et surtout pas les décideurs, à l'obligation qui nous est démocratiquement faite d'être en permanence créatifs. Imagine-t-on que des notions aussi désuètes que « passif » et « actif », qui sentent le petit commerce et le bas de laine, pour tout dire le pétainisme rampant, pourraient s'appliquer sans préjudice aux innovations d'un Haberer, d'un Messier, d'un Berlusconi ? Ce serait comme d'évoquer le savoir-faire, le métier, ou même, comble de ringardise, l'idéal du beau, à propos des performances ou des installations d'un artiste contemporain.
les termes génériques et les mots abstraits Il se trouve cependant une exception, et des plus précoce, puisque Tocqueville notait déjà dans son ouvrage sur la toute première démocratie de masse que « les peuples démocratiques aiment passionnément les termes génériques et les mots abstraits, parce que ces expressions agrandissent la pensée et, permettant de renfermer en peu d'espace beaucoup d'objets, aident le travail de l'intelligence ». Et il ajoutait ceci, qui décrit par avance l'immense carrière ouverte aux futures sciences sociales par ce besoin d'agrandir la pensée : « Les écrivains démocratiques font sans cesse des mots abstraits de cette espèce, ou ils prennent dans un sens de plus en plus abstrait les mots abstraits de la langue. »
donner du sens à l'économie donner du sens à l'économie. On peut affirmer que les hommes du passé, jusqu'au milieu du XXe siècle en tout cas, n'eussent point parlé de la sorte ; il ne serait jamais venu à l'esprit d'aucun d'entre eux d'user des mots sens et économie sans les particulariser de quelque façon, et ils auraient plutôt renoncé à s'en servir que de consentir à les laisser dans une telle indétermination. Ils auraient cru nécessaire de qualifier l'économie, de la définir par exemple comme capitaliste, de préciser en quoi elle pouvait être dite insensée, ou bien quel sens au juste il s'agissait de lui donner. Même leurs slogans les plus lapidaires renvoyaient ainsi, en dépit de la simplification inhérente au genre, à un ensemble de jugements et de partis pris, présents au moins en arrière-plan, et visaient à créer la division dans la société, à y nommer des intérêts tranchés pour les opposer à d'autres. Rien de tel dans une formule comme donner du sens à l'économie, où personne ne peut rien trouver de choquant, de terroriste, d'antidémocratique. Bref, un aussi généreux programme eût été strictement impossible à formuler en archéolangue. Ceux dont elle entravait l'esprit étaient bien en peine d'accéder à ces abstractions qui font la pensée plus vaste et l'expression plus rapide.
La Révolution française La Révolution française fit passer dans les faits une part au moins de ce programme, et du même coup commença à régulariser la langue comme elle tentait de régulariser les mœurs. Ses innovations linguistiques ne furent peut-être pas toutes heureuses, mais elles furent toutes inspirées : on y sent frémir l'avenir. Arrestation, culpabilité, rationner, et tant d'autres termes dès lors passés dans l'usage avec les progrès de l'administration, disent assez que le citoyennisme d'aujourd'hui était tout entier contenu dans le civisme d'alors. Et c'est à cette filiation que la novlangue rend hommage quand elle dénomme citoyen relais celui qui informe l'autorité d'une infraction dont il se trouve avoir connaissance.
système métrique Mais c'est sans doute l'adoption du système métrique qui reste la meilleure illustration des innovations, à la fois administratives et linguistiques, de la Révolution, celle qui en révèle le mieux le sens profond. On s'est beaucoup récrié, chez les puristes, devant les néologismes introduits par le nouveau système de mesures. Cependant ces termes, dénoncés comme barbares, ont été acceptés avec le temps et entérinés par l'usage : « l'extraordinaire kilo », dont Remy de Gourmont disait encore en 1900 qu'il était « une perpétuelle insulte au dictionnaire français », est si bien passé dans le langage courant qu'on a pu parler à un moment de kilofrancs. À l'instar de bien d'autres termes de l'époque révolutionnaire auxquels était prédit un rapide oubli, comme celui de simultanéité par exemple, ceux qui avaient été créés avec la nouvelle méthode de mesure sont devenus au contraire si familiers que ce sont les anciens mots servant à désigner des distances, des surfaces, etc., qu'il faut péniblement traduire. Même dans l'imprimerie, où l'arriération technique et le corporatisme avaient longtemps, qu'il s'agisse des formats de papier ou des mesures typographiques, favorisé le maintien de l'ancien système et de son vocabulaire archaïque, la rationalisation industrielle a fini par en venir à bout. Comme souvent dans les querelles intellectuelles ou esthétiques, le pivot de la discussion est ce dont on ne veut pas parler. On s'élève contre ce qu'il paraît élégant et raffiné d'appeler un charabia, mais on ne dit rien des transformations historiques dont ce prétendu charabia participe. Au mieux, on y voit un progrès dans l'abstraction, et certes, le mètre, dix-millionième partie du quart du méridien terrestre avant d'être égal à 1 650 763,73 longueurs d'onde de la radiation orangée du krypton, ne peut être, à la différence des anciennes unités de mesure, rapporté par personne à quelque réalité sensible que ce soit. Ce gain pour l'abstraction scientifique n'acquit d'ailleurs toute sa portée que parce que l'adoption du système métrique fut complétée par celle de la numération décimale comme module constant du nouveau système. Le but étant d'uniformiser l'ensemble des mesures, le système monétaire fut lui aussi «décimalisé», et en 1793 la Convention décida de procéder de même avec la mesure du temps, en créant des décijours et des centijours. Ce dernier projet, qui aurait parachevé l'égalisation, resta pourtant sans suite. Quoi qu'il en soit, cet indiscutable progrès dans l'abstraction n'est pas tout, ou plutôt, comme dans le cas d'autres transformations du même genre, c'est en considérant ce qu'il détruit que l'on comprend le mieux ce qu'il apporte. L'ancien système de mesures, si peu systématique qu'il ait été, n'était pas principalement caractérisé par sa variété : il aurait pu être unifié à l'échelle du pays, comme ce fut le cas en GrandeBretagne, sans changer pour autant de nature. Son caractère premier, indépendamment des variations locales qui furent invoquées pour l'abolir, était non seulement d'être directement lié à l'expérience sensible, mais surtout de reposer, dans ses unités comme dans leurs combinaisons, sur l'activité corporelle, sur le travail physique des artisans, paysans ou « manouvriers ». Ses unités, c'étaient les parties du corps, pied, pouce, coudée, brasse, ou encore les grandeurs que l'on estimait par rapport au travail humain, comme dans ouvrée, surface qu'un homme seul pouvait labourer en une journée. Et chaque corps de métier définissait et dénommait ainsi ses propres unités de mesure en fonction des réalités matérielles et de l'utilité pratique. Quant aux combinaisons de ces unités, le module duodécimal permettait à chaque artisan de concevoir aisément, à l'aide du fractionnement ou de la multiplication par trois et quatre, les rapports de grandeur qu'il avait besoin d'évaluer. L'adoption du système métrique et de sa terminologie représente donc plus que toute autre chose un affranchissement par rapport au travail manuel, à ses contraintes et à ses peines. Cet affranchissement ne fut alors qu'intellectuel, et il restait à en réunir les moyens matériels. Il pouvait en conséquence passer pour une simple vue de l'esprit, arbitraire et chimérique, sur laquelle on ne se priva pas d'ironiser. Mais par la précision et la régularité impersonnelles qu'il introduisait, il annonçait l'émancipation réelle qui serait l'œuvre du machinisme. Il faisait même mieux que l'annoncer, il la rendait possible, y préparait les esprits, et les néologismes qu'il imposa peuvent donc être tenus pour les présages objectifs d'une nouvelle ère. En effet, comme je vais le montrer bientôt, l'instauration de la novlangue est indissociable de l'avènement des machines.
J'ai bugué la formation d'un verbe à partir du terme anglo-américain bug, verbe utilisé sous la forme active, et non plus seulement au participe passé, pour dire d'un programme informatique qu'il est bugué. Un enfant qui apprend le piano et fait une fausse note dira ainsi très naturellement : « J'ai bugué. » On voit ici à quel point les puristes méconnaissent les lois qui président à l'évolution de la langue, et en particulier la force de propagation des images fondées sur l'expérience commune, puisqu'ils en sont encore à proposer, pour sauver quelque chose de l'archéolangue, de remplacer bugué par « vérolé » ou « infecté ». C'est à de telles absurdités qu'aboutit inévitablement la volonté puriste de fixer la langue, d'entraver le libre jeu de l'imagination, qui n'a jamais cessé de transformer et d'enrichir le lexique en transposant des mots d'un ordre d'idées dans un autre. Le mot bug lui-même, qui en anglais signifie au départ punaise, a dû faire un long chemin, que je ne retracerai pas ici, avant d'en arriver à désigner une sorte de vérole informatique. Puis il est passé en français, et enfin son sens a été élargi pour qu'il serve à désigner commodément et brièvement tout dysfonctionnement, qu'il soit le fait d'un ordinateur ou d'un homme : l'ordinateur, auquel nous avions prêté l'aptitude à être convivial, nous a rendu celle à buguer. Certes il y a là ce que les anciennes rhétoriques appelaient une catachrèse, un abus de langage, mais on ne pourrait prononcer ou écrire deux phrases de suite si l'on voulait ramener tous les mots à l'exacte portée qu'ils avaient à l'origine. Et quant à l'emprunt à une langue étrangère, Bréal en avait fort sensément dit, il y a plus d'un siècle, tout ce qu'il y a à en dire : « A toute époque, chez toutes les nations, il s'est trouvé des puristes pour protester contre ces emprunts. Mais ceux qui forment le langage, voulant avant tout être compris, et être compris aux moindres frais, s'inquiètent peu de la provenance des matériaux qu'ils mettent en œuvre. »
l'automobile en ne voyant qu'un objet isolé, tel que son utilité ponctuelle le fait passer pour bénin et de peu de conséquences. En revanche, dès qu'on le considère comme partie intégrante d'un ensemble, tout change. Et ainsi l'automobile, machine on ne peut plus triviale et presque archaïque, que chacun s'accorde à trouver bien utile et même indispensable à notre liberté de déplacement, devient tout autre chose si on la replace dans la société des machines, dans l'organisation générale dont elle est un simple élément, un rouage. On voit alors tout un système complexe, un gigantesque organisme composé de routes et d'autoroutes, de champs pétrolifères et d'oléoducs, de stations-service et de motels, de voyages organisés en cars et de grandes surfaces avec leurs parkings, d'échangeurs et de rocades, de chaînes de montage et de bureaux de « recherche et développement » ; mais aussi de surveillance policière, de signalisation, de codes, de réglementations, de normes, de soins chirurgicaux spécialisés, de « lutte contre la pollution », de montagnes de pneus usés, de batteries à recycler, de tôles à compresser. Et dans tout cela, tels des parasites vivant en symbiose avec l'organisme hôte, d'affectueux aphidiens chatouilleurs de machines, des hommes s'affairant pour les soigner, les entretenir, les alimenter, et les servant encore quand ils croient circuler à leur propre initiative, puisqu'il faut qu'elles soient ainsi usées et détruites au rythme prescrit pour que ne s'interrompe pas un instant leur reproduction, le fonctionnement du système général des machines.
plier le langage aux rigueurs d'un automatisme Après avoir cru que la traduction automatique était chose aisée, on est donc revenu de cette erreur pour tomber dans celle, inverse, consistant à croire qu'elle était impossible, et que jamais on ne parviendrait à plier le langage aux rigueurs d'un automatisme. Or, c'est précisément ce qu'on voit s'accomplir avec la rationalisation technique de la vie : le domaine où l'automatisation du passage d'une langue à une autre peut être opérée sans déperdition dommageable d'information est désormais en extension permanente. Il recouvre peu à peu l'ensemble des textes techniques et scientifiques, le langage médiatique dans sa quasi-totalité, les rapports d'experts et écrits divers émanant des institutions internationales comme plus généralement de toutes les équipes de gestionnaires, qu'elles soient gouvernementales ou non. Les mêmes traits sont chaque fois présents : syntaxe élémentaire, grande fréquence d'expressions toutes faites, termes abstraits n'appelant l'évocation d'aucun contexte précis ou au contraire étroitement déterminés, spécifiques et univoques.
work in progress Car où peut-on voir réalisé le grandiose programme que s'était donné la poésie moderne après Baudelaire ? Certes pas dans les oeuvres, toujours plus décevantes, de ceux qui se disent encore poètes. Où pratique-t-on sans relâche l'expérimentation verbale affranchie de toute syntaxe, afin qu'éclate « le feu des significations multiples » ? Où l'effacement de l'auteur s'accomplit-il le plus radicalement, cédant l'initiative aux mots, « par le heurt de leur inégalité mobilisés » ? Où se trouve le mieux provoquée l'intervention du lecteur, où sont accumulés indéfiniment les effets de surprise, de choc, de montage et de démontage propres à la tradition de l'innovation permanente ? Où, enfin, s'abolissent les données immédiates de l'expérience sensible pour ouvrir un immense espace de liberté à la subjectivité de tous, bref, où donc resplendit la pure poésie, automatisée, impersonnelle, libre jeu du langage avec lui-même dans lequel les mots « s'allument de reflets réciproques comme une virtuelle traînée de feux sur des pierreries » ? Où, sinon dans ce work in progress qu'élabore jour après jour la communauté des internautes, pivot caché autour duquel tournent tous les dialectes de la novlangue, « panthère parfumée » dont on sent l'haleine partout mais qui ne réside nulle part.
la poésie de l'hypertexte mondial Les fruits ont donc passé la promesse des fleurs. Rimbaud avait dit : « Le temps d'un langage universel viendra. » Et Lautréamont : « La poésie personnelle a fait son temps de jongleries relatives et de contorsions contingentes. » Mais c'est la créativité collective libérée par le réseau qui l'établit irrévocablement : l'illusion de la pensée individuelle est « l'idiotie » par excellence, Internet annonce et réalise progressivement l'unification de tous les textes en un seul hypertexte, la fusion de tous les auteurs en un seul auteur collectif, multiple et contradictoire. Il n'y a plus qu'un seul texte immense qui s'écrit sans relâche, chantier électronique mondial d'une Tour de Babel inverse à l'achèvement de laquelle il n'y aura plus qu'une langue pour le genre humain. D'autres, plus timorés, ont préféré parler à propos d'Internet de « bibliothèque communiste mondiale », mais c'était rester attaché à la seule consommation d'informations, alors que la communication sur le réseau est avant tout production, poiêsis, laboratoire quasi alchimique où s'élabore la novlangue totale. Ce dont avait rêvé Alfred Jarry, faire dans la route des phrases un carrefour de tous les mots, nous le voyons ainsi s'accomplir sous nos yeux : la poésie de l'hypertexte mondial est un fleuve à haut débit, majestueux et fertile.
instantanéité électronique C'est pourquoi il n'y a pas lieu de faire un sort à l'irréversible déclin du subjonctif, mode dont un grammairien d'autrefois avait pu dire que c'était par excellence le «mode de l'énergie psychique », et qui ne survivait plus qu'en tant que simple servitude grammaticale. Ce n'est que la manifestation la plus apparente d'une normalisation de la syntaxe qui désensorcelle le langage en tranchant tous les liens qui l'unissaient encore à la pensée magique, au monde des « énergies psychiques » et des participations mystiques. Comment le système des modes et des temps verbaux qui nous vient de ce monde archaïque serait-il encore adapté à nos besoins, alors que nous vivons dans le monde de l'instantanéité électronique, où le réel comme le virtuel nous sont livrés en quelque sorte prêts à l'emploi, sans que nous ayons à mobiliser quelque capacité intérieure de nous les représenter ? Et puisque vous avez mentionné le rôle de la mémoire dans la stabilité de la langue, parlons-en. Vous avez l'air de croire que nous devrions, comme des sauvages, charger notre mémoire de tout ce qu'il nous est donné de percevoir, penser, éprouver, imaginer, croire. Mais c'est au moins depuis l'invention de l'imprimerie, sinon de l'écriture, que notre mémoire a été secondée par des moyens techniques et, devenant par là toujours plus paresseuse, progressivement suppléée par celle des machines, qui fixent pour nous connaissances et souvenirs. Comment éprouverions-nous encore le besoin d'exprimer ce que nous ne retenons plus, parce que des machines s'en chargent pour nous ? Ainsi quand l'enregistrement, la reproduction et la diffusion des images sont devenus si aisés, la capacité d'attention visuelle s'étiole. Un appareil photo est une mémoire visuelle automatique, et là où Goethe disait qu'il n'avait vraiment vu que ce qu'il avait dessiné, l'utilisateur d'une telle machine n'encombrera pas sa mémoire de ce qu'elle aura numérisé, et qu'il pourra donc commodément conserver dans son ordinateur personnel, pour un jour le mettre en ligne sur son blog. Mais le dépérissement de la mémoire n'est pas seulement dû aux facilités techniques d'enregistrement, ni à l'informatique. N'importe quelle machine inventée depuis au moins deux siècles avait intégré en elle, cristallisé, le temps précédemment nécessaire à l'acquisition et à la mise en œuvre des savoir-faire manuels qu'elle supplantait. Elle a ainsi soustrait les rythmes et les délais constitutifs de ces activités au temps vécu et à la mémoire individuelle, les rendant propres à être compactés par l'instantanéité informatique. Avant que les linguistes eussent appris à ne pas mêler l'histoire à leurs travaux, ils avaient observé qu'avec les progrès de la civilisation s'étaient perdues pour une grande part la richesse et la précision dans l'expression des notions d'ordre spatial ; et qu'en contrepartie s'étaient développés les moyens d'exprimer la notion plus abstraite du temps. Nous voyons maintenant, à un stade plus perfectionné de la même civilisation, ces moyens se perdre à leur tour, faute d'usage.
armoires à pharmacie Quand la langue devient d'un solide prosaïsme, on peut donc, si l'on veut, parler d'appauvrissement, mais alors au sens où, en regard de la luxuriance des illusions et fantaisies de l'imagination, le vrai est aride ; au sens où la formule chimique d'un parfum, qui en donne la composition exacte, peut néanmoins paraître plus pauvre que l'évocation poétique de ses fragrances ; ou encore au sens où les privations qu'acceptent un ascète ou un sportif leur permettent d'améliorer leurs performances dans leurs domaines respectifs. Car la disparition de la mauvaise graisse du langage, la restriction dans le domaine de l'expression sentimentale et subjective, se trouve compensée, et au-delà, par l'extension constante du vocabulaire utile à notre information objective. Nous gagnons en précision ce que nous perdons en imagination, et c'est ce dont nous avons surtout besoin dans notre environnement technique qui, contrairement à la confuse et surprenante variété qui était celle du monde naturel, nous est en quelque sorte livré déjà ordonné, organisé selon une rationalité fonctionnelle. Cette « seconde nature » que nous a fabriquée l'industrie, c'est en novlangue qu'en sont rédigés la taxinomie et le mode d'emploi : sans cesse s'étendent et se précisent les terminologies techniques, les nomenclatures commerciales, les règles de langage administratives, les vocabulaires spécialisés, etc. Il en va ainsi de la novlangue comme de nos armoires à pharmacie, qui s'agrandissent toujours et se remplissent de nouveaux produits de la science, sans que nous puissions jamais être sûrs de nous être pour autant rapprochés de la santé. Car la sobre grandeur de la science réside précisément en cela, d'avoir renoncé à la quête illusoire d'un Tout achevé pour progresser indéfiniment dans la connaissance.
les publicitaires, ces poètes de la marchandise Les jeunes des cités jouent d'une certaine façon, pour les philosophes de la postmodernité, le rôle des « bons sauvages ». En tant qu'avant-garde de l'adaptation au nouveau milieu technique, ils y adoptent en effet, et d'autant plus facilement qu'ils ne sont pas entravés par l'espèce d'éducation qu'ils ont reçue, une mentalité en harmonie avec la totalité de la vie artificielle : ils y pratiquent, en nomades ou en pillards, une sorte de cueillette ou de rapine, d'informations, de sensations, de satisfactions rapides. Le langage dans lequel s'exprime une telle expérience paraît ainsi refaire en sens inverse le chemin parcouru par les langues civilisées, revenir de l'abstraction à l'expression de notions concrètes, et se remplir de catégories mystiques et subjectives. Mais en réalité, chez ces enfants de l'instantanéité électronique, l'intensité des sensations et le contenu fugitif de la conscience font adopter une langue qui n'est mystique ou subjective qu'au second degré, en quelque sorte, car c'est à des produits rationnels de l'industrie qu'elle confère des qualités fantastiques ou des propriétés magiques, comme le faisait la metalité primitive avec les réalités naturelles. Le pouvoir des noms, la création de légendes onomastiques, l'emploi des formules et des sortilèges, l'interdiction de certains mots, tous ces traits de la langue archaïque se retrouvent dans le parlerjeune, mais ils se rapportent maintenant à des marques commerciales, à des vedettes, à des styles de consommation. C'est la pensée spontanément magique du cosmos des marchandises qui s'exprime là, et c'est pourquoi les publicitaires, ces poètes de la marchandise, vont y chercher la vigueur et la saveur que possède seul un langage aussi primitif.
la plus adéquate au monde que nous nous sommes fait Je crois avoir dit tout ce qu'il est raisonnablement possible de dire en faveur de la novlangue, et même un peu plus. Après cela, je ne vois pas ce que l'on pourrait ajouter de plus convaincant pour en faire l'éloge. Cependant, l'ayant défendue en tant qu'elle est la plus adéquate au monde que nous nous sommes fait, je ne saurais interdire au lecteur de conclure que c'est à celui-ci qu'il lui faut s'en prendre si elle ne lui donne pas entière satisfaction.
fin des extraits.
|
Acheter ce livre :
Pour obtenir ce livre, 2 solutions :
1- Contacter l'éditeur :
Adresse postale :
Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances
80 rue de Ménilmontant
75020 PARIS
Téléphone-télécopie : 01 43 49 39 46
2- La librairie de diffusion :
Adresse postale :
Société d'Édition les Belles Lettres
25 rue du Général Leclerc
94270 LE KREMLIN BICÊTRE
Téléphone : 01 45 15 19 70 ou 01 45 15 19 90
Télécopie : 01 45 15 19 99
[Accueil] [Notes de lectures] [Examens] [Lexiques] [Liens] [Statistiques] [Recherche] Plan du site [Archives] [Esprit Critique] [Trucs et astuces] [Création de site] ! Délire java ! Courriel :Sitécon
la copie est nécessaire le progrès l'exige.