<< Sommaire : Notes de lectures
On ne supprimera
jamais la pauvreté
Même pas vrai !
On ne supprimera
jamais la pauvreté
Même pas vrai !
Antoine Sondag
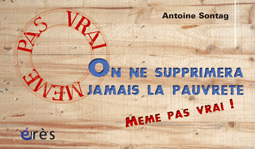
©2005
Même pas vrai ! - collection dirigée par Patrick Ben Soussan
ISBN : 2-7492-0521-2
18 x 10,5, 120 pages
8.00 €
 |
Quatrième
de couverture : Nos sociétés modernes ont les
moyens d’éradiquer la pauvreté, à court
terme dans les pays industrialisés, et à moyen terme
sur la planète entière. Nous en avons les capacités
financières, les moyens techniques, le savoir-faire.
Mais il nous manque la volonté politique. Nous cherchons
à fuir cette vérité qui dérange. On invoque alors
toutes ces évidences de sens commun, ces maximes de
café du commerce, une psychologie de bazar pour nous
expliquer qu’il y aura toujours des pauvres. |
 |
Extraits .../... Qui
paiera l'assurance ? .../... En France, sont des pauvres (monétaires) ceux dont les revenus n'atteignent pas 50 % du revenu médian. Pour les statistiques de l'Union européenne qui sont plus généreuses, la ligne de pauvreté est au-dessus de ce minimum puisqu'on prend 60 % du revenu médian. Ainsi on obtient une proportion de pauvres pour la France de 10 % ou de 16 %, soit 6 millions dans le premier cas et environ dix millions de personnes selon les statistiques de l'Union européenne. .../... La
pauvreté relative est en fait une manière de
mesurer l'inégalité. Dans une société donnée, le
sentiment de ne pouvoir participer aux activités
considérées comme " normales " est le
fondement de la pauvreté. C'est à la fois un regard
porté sur la personne et un sentiment intériorisé. Le
pauvre se perçoit comme tel. 25 % des titulaires du RMi
en France n'avouent pas à leurs proches qu'ils le
perçoivent (le montant est pourtant insuffisant pour
vivre correctement), ils intériorisent la honte d'être
pauvre, et ce sentiment fait d'ailleurs partie de la
pauvreté ! Les
inégalités s'accroissent .../... |
 |
Certains
parlent du traitement social du chômage... D'autres
prônent la flexibilité, la mobilité,
l'adaptabilité... Les maux et les recettes sont connus,
identifiés, nommés : mondialisation, délocalisation,
libéralisme, concurrence, réduction des coûts du
travail, guerre économique... Pour sauver l'emploi, on
tue l'emploi durable pour l'emploi ajustable. Les
victimes collatérales que sont les plus pauvres pèsent
peu face à ces logiques économiques et politiques. Au
milieu de ces logiques, quelle place y a-t-il pour la
personne la plus fragile, la plus vulnérable ? Peut-on
construire son avenir sur du tout précaire et du
précaire durable ? Le précaire sème le désespoir. Or
une vie se construit sur de la perspective, du projet, de
l'espoir 1 ... " 1. Dossier de presse du Secours Catholique, 2004, France précaire, p. 13. .../... Un
indicateur de " pauvreté administrative " .../... La réflexion sociale s'est centrée sur l'exclusion. Un exclu ne sert à rien, ce qui n'était pas le cas du prolétaire. II est exclu non seulement du monde du travail mais aussi de multiples possibilités de participation sociale. II vit dans un monde privé de sens : sa situation, ses souffrances... ne servent à rien, n'ont pas de sens. C'est pourquoi il y a si peu de mouvements organisés de chômeurs, de pauvres ou d'exclus dans une France qui compte plus de chômeurs que de syndiqués. Le chômage est plus insidieux qu'il n'y paraît dans la société moderne. C'est que le chômeur est triplement exclu : du travail, de la participation sociale, du sens. Le manque de travail a des conséquences financières mais aussi sociales car le travail reste la principale source de socialisation et d'intégration : les femmes veulent travailler en dehors du foyer pour avoir une vie sociale qui ne se limite pas aux enfants ; un des principaux moyens d'intégration des étrangers continue d'être le travail. Le manque d'emploi a aussi des conséquences psychologiques pour la personne affectée : le chômage touche à l'image que chacun se fait de lui-même; il installe un doute dans la personnalité du chômeur. C'est comme si la société disait : " Nous n'avons pas besoin de vous. Nous vous donnons certes une allocation, car nous ne voulons pas vous voir dépérir, mais vous ne servez à rien. La société (des riches) tourne sans vous. " .../... Pour apprécier la situation des catégories défavorisées en France, il faut certes accorder toute sa place au niveau des revenus : ces statistiques sont aujourd'hui bien maîtrisées. Une autre donnée importante est la stabilité du revenu, qui ouvre la voie au crédit bancaire et à la possibilité de s'endetter, donc à l'accession à un logement dans un quartier plus ou moins cher. Les statistiques sur ce sujet sont moins disponibles ou moins connues. Par ailleurs, la stabilité du revenu est liée davantage au niveau des diplômes qu'à celui des rémunérations. Autrement dit, les diplômes procurent en moyenne des revenus plus élevés, ce qui paraît évident, mais plus encore - et la corrélation est plus importante -, ils ouvrent l'accès à des professions qui garantissent la stabilité du revenu, déterminante pour le système bancaire comme aptitude à pouvoir s'endetter... donc acheter un logement à crédit. À nouveau, éducation et logement ont partie liée. .../... On ne peut réduire la question des clivages sociaux en France à celle des " quartiers ". II est plus réaliste d'observer la ségrégation sociale à l'oeuvre qui se manifeste aussi bien dans la recherche d'un logement que dans le choix d'une école pour les enfants.Tout cela illustre les évolutions sociales. Le travail joue un rôle moins important dans la ségrégation, une partie importante des gens se retrouve " noyée " dans un vaste magma de professions intermédiaires. D'autres critères prennent le relais pour servir de marqueurs sociaux et de leviers de différenciation (logement, école). L'école joue un rôle d'autant plus important qu'elle favorise le caractère " héréditaire " des inégalités, des discriminations. |
 |
.../... Pour certaines personnes,
installées durablement dans des réseaux d'urgence,
l'insertion est hors d'atteinte : étrangers sans
papiers, déficients mentaux dans la rue depuis
longtemps, clochards de très longue date... Cette
fidélisation des clients est en contradiction absolue
avec les objectifs des institutions en question. La
structure sociale n'est plus un relais favorisant
l'insertion, elle est devenue un relais entre la rue et
la rue. .../... La participation des personnes victimes ou menacées d'exclusion sociale et le partenariat avec elles sont considérés comme très importants dans les discours officiels des autorités publiques. Mais la France a souvent beaucoup de mal à passer du discours aux pratiques innovantes. II faut dire qu'elle compte très peu d'associations de personnes concernées. Combien y a-t-il d'associations qui regroupent le million de titulaires du RMI ? Où sont ces gens ? Ont-ils peur de se regrouper ? Pourquoi ? Tant de questions, mais peu de réponses. Les grandes associations caritatives, qui sont les partenaires des pouvoirs publics, se cantonnent à la solidarité, mais il n'y a pas d'associations d'exclus. Pourtant, tous s'accordent à dire que seule une politique participative de lutte contre la pauvreté a des chances de connaître le succès. .../... |
 |
Distinction
entre les pauvres " malhonnêtes" et les
pauvres " honnêtes" À l'époque prémoderne, on distingue les pauvres malhonnêtes et les pauvres honnêtes. II y a d'un côté les gens valides, capables de travailler, mais préférant mendier et voler; d'un autre côté, ceux qui se trouvent privés de moyens d'existence. Cette distinction sert de base pour distribuer les aumônes et distinguer les " bons " des " mauvais " pauvres. On établit des listes de pauvres pour éviter qu'ils ne se présentent plusieurs fois lors des distributions d'aumônes et on introduit des jetons ou des insignes.Très vite, on veut contrôler les pauvres, les compter, faire des statistiques... mais aussi les fixer, les empêcher de " divaguer ", de " cheminer ". On dit d'eux qu'ils sont sans feu ni lieu. La figure du pauvre se confond avec celle de l'errant. (Cette vision a la vie dure et pour beaucoup encore aujourd'hui les pauvres, ce sont les SDF, ceux qui errent, qui divaguent.) Pour mettre de " l'ordre ", on établit que pour avoir droit aux aides, il faut que les pauvres s'enregistrent, se fixent quelque part, aient un domicile, soient connus de quelques notables, qui donc pourront les contrôler. Assistance et répression La société prémoderne offre l'assistance sociale des hospices et des institutions religieuses (monastères...) où la charité est prise en charge par l'Église. Ceux qui échappent à ces institutions qui aident et contrôlent en même temps sont susceptibles d'être poursuivis. Ils sont considérés comme dangereux. Assistance et répression, pitié et méfiance, cette ambivalence face aux pauvres a été symbolisée par deux mots : la potence et la pitié. Les deux attitudes pouvaient être apliquées simultanément ; elles sont hélas ! encore d'actualité. Pauvreté, vice et dangerosité Une idée a la dent dure : la pauvreté mène au vice, elle est dangereuse et doit donc être réprimée. Un édit royal de 1656 ordonne l'enfermement des pauvres de Paris dans un hôpital général. En 1662, il est étendu à toutes les villes de France. L'enfermement met fin au désordre apparent de la pauvreté, mais cela laisse sans réponse la question de l'occupation du pauvre : que fait-il dans ces institutions où il est confiné ? Le XXe siècle a vu le retour de ces vieilles idées. Certains maires ont pris des arrêtés contre la mendicité ; ils ont interdit aux errants et à leurs chiens de stationner, de " rester là sans rien faire ". Dans plusieurs villes de France, des maires ont pris des arrêtés de " déportation " des SDF pendant la saison touristique. II existe aujourd'hui, dans certains pays, et la France n'est pas à l'abri de cette dérive, une tentative de pénaliser la pauvreté et d'enfermer les pauvres en prison. Cette constatation brutale émane de statistiques sur l'origine sociale des détenus dans les prisons aux États-Unis ou en France. Les prisons sont faites plus pour les pauvres que pour la moyenne de la population. Aux États-Unis, les Noirs peuplent les prisons largement au-delà de leur proportion dans l'ensemble de la population. En France, les étrangers sont sur-représentés dans les prisons. En Russie, les prisons regroupent près d'un million de détenus ; on doit certes incriminer l'héritage soviétique qui était très répressif ; on peut considérer aussi que criminaliser la pauvreté est une manière de la gérer. .../... Nous avons les moyens
financiers, mais nous n'avons pas la volonté politique
d'éliminer la pauvreté à l'échelle planétaire.
Voilà ce qu'il y a de vraiment nouveau, voilà le
scandale ! Fin des extraits. |
[Accueil] [Notes de lectures] [Examens] [Lexiques] [Liens] [Statistiques] [Recherche] Plan du site [Archives] [Esprit Critique] [Trucs et astuces] [Création de site] ! Délire java ! Courriel :Sitécon
la copie est nécessaire le progrès l'exige.