Bac. SES épreuse de
Sciences économiques et sociales
juin 2006
Dissertation : Internationalisation et emploi
Quels sont les effets de l'internationalisation des échanges sur
l'emploi dans les pays industrialisés ?
Document 1
Répartition du commerce mondial : exportations en lignes,
importations en colonnes
Taux de croissance annuel moyen en volume 1995-2002 (en %) |
Part dans le commerce mondial en 2002 (en %) |
|||
Nord |
Sud |
Nord |
Sud |
|
Nord |
3,7 |
5,5 |
55,8 |
17,5 |
Sud |
9,7 |
8,8 |
20,2 |
6,5 |
Lecture : les exportations de pays du Nord
à destination des pays du Sud ont augmenté en moyenne par an en
volume de 5,5 % entre 1995 et 2002. En 2002, les exportations des
pays du Nord à destination des pays du Sud représentaient 17,5%
du commerce mondial.
Note : le "Nord" comprend ici les pays développés de
l'OCDE, Taiwan, Hong Kong et Singapour ; le "Sud", le
reste du monde.
Source : La Lettre du CEPU, n°231, février 2004.
Document 2
La concurrence internationale serait un moteur essentiel de
l'innovation. Seulement, dans certains secteurs, les innovations
sont parfois difficiles à appliquer ou à rentabiliser. C'est
notamment le cas des secteurs traditionnels comme celui de la
chaussure. La délocalisation de tout ou partie du processus
productif peut alors s'avérer nécessaire pour échapper à la
concurrence internationale. [...]
Les données fournies par les enquêtes révèlent néanmoins que
la stratégie privilégiée des entreprises reste la
différenciation des produits. [...]
Concrètement, cette politique signifie que l'entreprise va
tenter d'offrir une plus grande diversité de produits que les
concurrents, d'accélérer leur renouvellement, ou encore de
personnaliser le service qui les entoure. L'idée est de coller
en permanence aux évolutions du marché dans un environnement
changeant et incertain. L'entreprise a donc un besoin impératif
d'être réactive, donc flexible.
Pour répondre à cet impératif, elle peut notamment introduire
des innovations techniques. On assiste alors à une entrée
massive de l'informatique et du numérique dans les processus
productifs. [...]
Les besoins en emplois des entreprises vont alors plutôt se
tourner vers les manipulateurs de symboles, les manieurs de
concept, ceux qui maîtrisent l'immatériel. Mais ils vont aussi
se tourner vers des travailleurs flexibles, aptes à effectuer
plusieurs tâches.
Source ; J-M. Cardebat et E. Maurin, Mondialisation,
innovation et emploi,
Les notes de l'IFRI n°49, 2003.
Document 3
Emploi total par branche - France
| Branches | Emplois (en milliers) |
Taux de croissance annuel moyen des emplois 1998-2003 (en %) |
Part des emplois de la branche dans l'emploi total 2003 (en %) |
|
1998 |
2003 |
|||
| Industrie dont industrie textile |
3 842,7 124,6 |
3 775,5 99,7 |
- 0,35 - 4,36 |
15,2 0,4 |
| Services
marchands dont postes et télécommunications |
10 052,6 428,5 |
11 508 487 |
2,74 2,6 |
46,3 2 |
| Ensemble industrie et services marchands | 13 895,3 |
15 283,5 |
1,9 |
61,4 |
Source : d'après INSEE ; Comptes nationaux.
Document 4
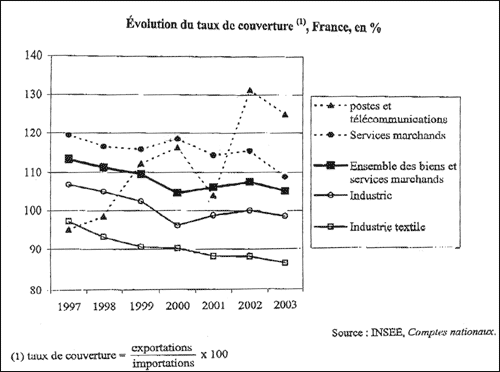
Document 5
Les délocalisations et la sous-traitance internationale
constituent simplement une nouvelle manifestation du
développement des échanges entre pays industrialisés et pays
émergents. Les bénéfices de ces échanges sont immédiats pour
le consommateur (du pays importateur) qui voit le prix de
nombreux biens de consommation chuter.
Le bénéfice est également évident pour les entreprises, qui
absorbent dans leur processus de production une part croissante
d'importations à bas prix en provenance du Sud, réalisant au
passage des gains de productivité. Une partie de ces gains se
retrouve dans les salaires ; une autre partie de ces gains se
retrouve dans la baisse des prix relatifs des biens
manufacturés, ce qui soutient la demande pour les produits
industriels.
Au passage, les délocalisations et la sous-traitance favorisent
l'émergence d'une demande solvable dans le pays émergent
accueillant ces usines : les exportations françaises à
destination de ce pays, notamment les exportations de produits à
plus fort contenu en main d'oeuvre qualifiée, bénéficient
ainsi d'un effet d'entraînement. [...]
La contrepartie de cette dynamique est une sélection des firmes
et des unités de production les plus efficaces. Or, les
fermetures d'usines sont concentrées sectoriellement et donc
géographiquement. Les impacts négatifs locaux sont donc
puissants : ils affectent de surcroît les catégories les plus
défavorisées et les moins mobiles (les non qualifiés).
Source : L Fontagné et J-H. Lorenzi, Désindustrialisation, délocalisations, Rapport du Conseil d'Analyse Economique, La Documentation française, 2005.
Document 6
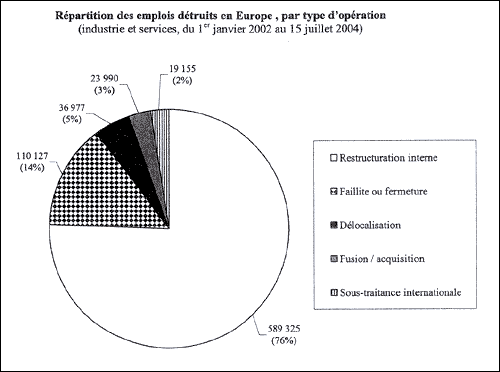
Note: les restructurations internes correspondent aux plans de réductions d'emplois menés par les entreprises dans le but de réduire les coûts de production et maintenir leur compétitivité.
Champ : l'Europe correspond ici aux 25 Etats de l'Union Européenne, plus la Bulgarie et la Roumanie.
Source : d'après European Monitoring
Monitor (EMCC),
Cahiers Français n°325, La Documentation française,
2005.
Question de synthèse : Syndicalisme et action collective
THEME DU PROGRAMME :
Conflits et mobilisation sociale
I - TRAVAIL PREPARATOIRE (10 points)
Vous répondrez à chacune des questions en une dizaine de lignes maximum.
1. Montrez que la baisse du taux de syndicalisation résulte en partie de transformations socioéconomiques. (document 1) (2 points)
2. L'institutionnalisation des syndicats n'a t-elle que des effets négatifs ? (document 1) (1 point)
3. Quels facteurs influencent le taux de syndicalisation ? (document 2) (2 points)
4. Exposez les transformations
significatives que ce graphique met en évidence.
(document 3) (2 points)
5. En quoi le conseil des prud'hommes illustre-t-il un des rôles actuels des syndicats ? (document 3) (1 point)
6. Montrez que le champ d'action des syndicats ne se limite pas à la gestion des conflits. (document 4) (2 points)
II - QUESTION DE SYNTHESE (10 points)
Après avoir expliqué les évolutions du syndicalisme, vous montrerez que les syndicats restent des acteurs importants de l'action collective.
Document 1
La France n'a jamais eu de syndicalisme fondé sur des
adhérents nombreux, sauf à certaines époques exceptionnelles
et dans des professions particulières. Déjà faibles, les taux
de syndicalisation ont connu cependant, depuis le milieu des
années soixante-dix, une chute rapide.
Les grands secteurs industriels, bastions des syndicats et
particulièrement de la CGT, ont connu de fortes diminutions
d'emplois, au profit d'activités commerciales et de services
souvent peu syndiquées. Les ouvriers sont moins nombreux, et ils
sont remplacés par des employés ou par des cadres.
Les salariés sont devenus plus "utilitaristes" que par
le passé vis-à-vis des syndicats : ils y font appel en cas de
besoin, sans s'y sentir engagés.
[Autre] cause de déclin, l'effacement du syndicalisme de
proximité au profit d'un syndicalisme
"institutionnalisé". Progressivement, les militants
syndicaux sont aspirés par de nouvelles tâches. En effet, les
syndicats s'impliquent plus dans la gestion paritaire (Assedic,
caisses de sécurité sociale). Des négociations d'entreprise se
développent, obligeant les militants à se professionnaliser.
Dans certaines entreprises, seuls les élus sont encore
syndiqués, et il ne leur est plus possible de mener une action
au quotidien, faute de relais à la base.
Source : Michel Cezard, Jean-Louis Dayan, Les Relations
Professionnelles en Mutation,
Données sociales, INSEE 1999.
Document 2
Syndicalisation et présence syndicale selon l'employeur, la
taille de l'établissement et les conditions d'emploi en France
en 2003
EN % DES SALARIÉS |
Taux de syndicalisation |
Présence syndicale sur le lieu de travail |
| État, collectivités locales, hôpitaux publics | 15,1 |
52,7 |
| Entreprises publiques, Sécurité sociale | 15,6 |
70,7 |
| Entreprises privées | 5,2 |
31,2 |
| Etablissements de moins de 50 salariés | 3,5 |
8.3 |
| Établissements de 500 salariés et plus | 8,7 |
81,2 |
| Salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim | 2,4 |
23,2 |
| Salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet | 9,5 |
42,5 |
| Ensemble des salariés | 8,2 |
38,5 |
Lecture : en 2003, 52,7 % des salariés de
l'Etat, des collectivités locales ou des hôpitaux publics
déclarent qu'un syndicat est présent sur leur lieu de travail.
Source : DARES, Première Synthèses, n°44, octobre 2004.
Document 3
Résultat des élections prud'homales en % (collège des
salariés)
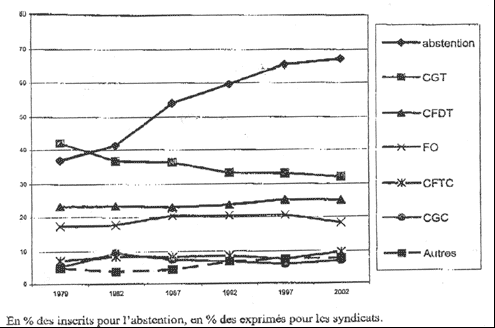
Le conseil des prud'hommes traite des litiges individuels entre employeurs et salariés, les conseils prud'homaux qui jugent ces litiges sont constitués à parité de représentants élus des organisations syndicales et patronales
CGT : Confédération générale du travail
CFDT : Confédération française démocratique du travail
FO : Force ouvrière
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
CGC : Confédération générale des cadres
Source : D. Andolfatto (sous la direction de), Les Syndicats
en France,
La Documentation française, 2004.
Document 4
Impliqué dans la cogestion des entreprises, le syndicalisme
allemand est puissant et, à la différence de la plupart des
syndicats européens, a connu une faible désyndicalisation au
cours de la dernière période. Près de 40% des salariés sont
impliqués et les syndicats allemands regroupent en 1993 environ
13 millions d'adhérents. La cogestion est une pierre angulaire
du système social. Elle concerne les entreprises de plus de 500
salariés. Salariés et organisations syndicales sont
représentés, avec voix délibérative, au sein du conseil de
surveillance des entreprises. Ce dernier se prononce sur les
grandes orientations et désigne le directoire qui assure la
conduite effective de l'entreprise [...].
Avec plus de 80% d'adhérents, le taux de syndicalisation en
Suède est un des plus élevés du monde. Le syndicalisme, outre
ses fonctions revendicatives de base, la défense des intérêts
professionnels des salariés, assume la gestion des caisses de
chômage en lieu et place de l'Etat.
Source : H. Landier, D. Labbe, Les Organisations Syndicales en
France, Editions Liaisons, 2004.
Questions : Tocqueville et la démocratie
THEME DU PROGRAMME :
Egalisation des conditions et démocratie
Document 1
II y a un passage très périlleux dans la vie des peuples
démocratiques. Lorsque le goût des jouissances matérielles se
développe chez un de ces peuples plus rapidement que les
lumières et que Ies habitudes de la liberté, il vient un moment
où les hommes sont emportés et comme hors d'eux-mêmes, à la
vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Il n'est
pas besoin d'arracher à de tels citoyens les droits qu'ils
possèdent ; ils les laissent volontiers échapper d'eux-mêmes.
L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un
contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie.
S'agit-il de choisir leurs représentants, de prêter main-forte
à l'autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps
leur manque. Pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs
affaires, ils négligent la principale qui est de rester maîtres
d'eux-mêmes [...]. La peur de l'anarchie les tient sans
cesse en suspens et toujours prêts à se jeter hors de la
liberté au premier désordre. Je conviendrai sans peine que la
paix publique est un grand bien ; mais je ne veux pas oublier
cependant que c'est à travers le bon ordre que tous les peuples
sont arrivés à la tyrannie. Il ne s'ensuit pas assurément que
les peuples doivent mépriser la paix publique ; mais il ne faut
pas qu'elle leur suffise.
Source : Alexis De Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, Robert Laffont 1999, (Première édition 1840).
Document 2
Le 21 avril 2002, au premier tour de l'élection présidentielle,
l'abstention s'est élevée à 28,4 %, près de sept points au
dessus de son niveau de 1995. Le second tour a connu une
mobilisation plus importante des électeurs (20,3 %
d'abstentionnistes) mais cette "mobilisation civique" a
été sans lendemain. Aux législatives suivantes, l'abstention
(35,6 %) a atteint un nouveau record. Quelle que soit la
nature des consultations, l'abstentionnisme électoral a connu
une progression qui a révélé l'ampleur de la crise de la
représentation politique. Parce qu'elle renvoie moins que par le
passé à l'inégalité de distribution du capital scolaire et à
la différenciation des statuts sociaux (Ie chômage demeurant
cependant un facteur de retrait), parce que les citoyens
sélectionnent les consultations en fonction de leurs enjeux,
l'abstention, intermittente, peut être lue comme un choix
politique parmi d'autres.
Source : Henri Rey, Sylvain Brouard, L'Etat de la France, édition 2005-2006, La Découverte.
QUESTIONS
1. À l'aide de vos connaissances et du document 1, vous mettrez en évidence les risques menaçant la démocratie selon Alexis de Tocqueville. (9 points)
2. Expliquez le passage souligné du document 1. (5 points)
3. L'évolution décrite dans le
document 2 confirme-t-elle les craintes de Tocqueville ? (6
points)
Questions : Keynes et la croissance
THEME DU PROGRAMME :
Sous-emploi et demande
Document 1
Que la confiance que j'éprouve soit ou non justifiée, je
n'ai en tout cas ni doute ni hésitation d'aucune sorte quant aux
causes de la crise mondiale. J'en fais remonter l'origine au seul
effondrement de l'investissement qui s'est produit dans le monde
entier. Après avoir été maintenu à un niveau passablement
élevé durant la majeure partie de l'après-guerre, le volume de
l'investissement a subi une profonde baisse au cours des deux
dernières années et demie, une baisse qui n'a jusqu'à présent
pas été totalement compensée par la réduction de l'épargne
ou par le déficit budgétaire.
Le problème de la reprise revient donc à savoir comment rétablir l'investissement. La solution a elle-même deux aspects : d'une part, une baisse du taux d'intérêt à long terme, et, d'autre part, un retour de la confiance parmi les hommes d'affaires qui les inciterait à emprunter sur la base d'anticipations normales. [...]
Le problème de la reprise est également lié au rétablissement du niveau général des prix. Il existe des raisons fondamentales pour vouloir une hausse des prix. Une de ces raisons concerne la stabilité et l'harmonie sociale. Une réduction vraiment importante d'une grande partie des salaires, qui, dans l'ensemble serait du même ordre de grandeur que la baisse des prix, est tout simplement impossible.
Source : J. M. Keynes, "La voie de la
reprise", Conférence du 02/07/1931,
La Pauvreté dans l'Abondance, Tel Gallimard, 2002.
Document 2
Taux de croissance annuel moyen de l'emploi, des dépenses de
consommation des ménages, de la FBCV et du PIB réel (en %)
| Evolution (en %) | 1998-2000 |
2001-2004 |
| Emploi | 2,1 |
0,6 |
| Dépenses de consommation des ménages en volume | 3,6 |
2,0 |
| Formation brute de capital fixe en volume | 7,5 |
1,5 |
| Produit intérieur brut en volume | 3,7 |
1,6 |
Source : d'après INSEE, Comptes nationaux, 2005.
QUESTIONS
1. A l'aide de vos connaissances et du document 1, vous présenterez les déterminants de la croissance et de l'emploi chez Keynes. (10 points)
2. Expliquez la phrase soulignée dans le document 1. (4 points)
3. Les données du document 2
confirment-elles l'analyse de Keynes ? (6 points)
[Accueil] [Notes de lectures] [Examens] [Lexiques] [Liens] [Statistiques] [Recherche] Plan du site [Archives] [Esprit Critique] [Trucs et astuces] [Création de site] ! Délire java ! Courriel :Sitécon
la copie est nécessaire le progrès l'exige.