Bac. SES épreuse de
Sciences économiques et sociales
juin 2005
Corrigé du sujet en bas de page
En quoi la dégradation du marché du
travail depuis le début des années 80 contribue-t-elle à
modifier le système de protection sociale français ?
Document 1
Jusqu'au début des années 1980, on pouvait
penser que les techniques classiques de l'Etat-providence,
assises sur le double registre de l'assistance et de l'assurance,
permettaient de répondre à toutes les situations. [...] Si le
RMI s'est finalement imposé, c'est que l'Etat et les
travailleurs sociaux se sont rendus compte qu'un nombre croissant
d'individus en situation de précarité n'appartenait à aucune
des catégories traditionnelles de l'action sociale. Toute une
partie des personnes vivant en dessous d'un certain seuil de
revenu n'étaient même pas identifiées. On a ainsi noté le
nombre élevé d'allocataires du RMI qui n'avaient jamais
bénéficié auparavant d'une aide sociale constituant ce que
l'on a pu appeler des personnes démunies "sans cause"
: ni licenciées, ni handicapées, ni âgées, ni en charge
d'enfants, elles n'avaient pas été touchées par les politiques
sociales catégorielles(1).
Source : Pierre Rosanvallon, La nouvelle
question sociale, repenser l'État-providence, Collection
Point, Le seuil, 1995.
(1) : Politiques ciblées sur certaines
catégories de population.
Document 2 :
Allocataires des principaux minima sociaux,
au 31 décembre de chaque année, en milliers.
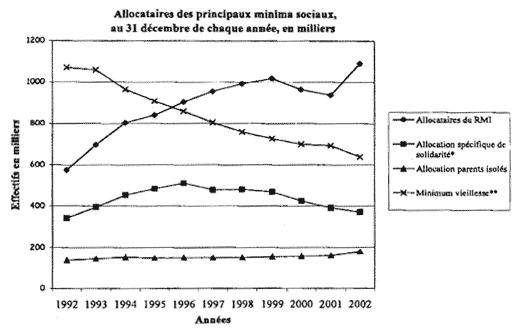
Source : d'après la Dares, Dossiers et Documents du Monde,
n°332, juin 2004.
* L'Allocation spécifique de Solidarité est versée par les
ASSEDIC aux chômeurs qui ont épuisé leurs droits aux
allocations d'assurance chômage.
** Instauré en 1956, le minimum vieillesse garantit que toute
personne âgée de plus de 65 ans à faible revenu et ayant peu
ou pas cotisé dispose d'un minimum de ressources. Depuis le 1er
janvier 2005, ce minimum est 599,5 euros par mois pour une
personne vivant seule.
Document 3
Depuis le début des années quatre-vingt,
les dépenses liées au chômage, à l'inadaptation
professionnelle et aux cessations anticipées d'activité ont
augmenté à un rythme annuel moyen de 2,6 % en termes réels. En
1996, ces dépenses représentaient 2,4 % du PIB contre 2,2 % en
1981. Mais face à la rapide augmentation des dépenses liées au
chômage, les conditions d'indemnisation ont été rendues plus
restrictives. [...]
Les cotisations sur les salaires sont l'élément principal du
financement du système de la protection sociale en France. La
faiblesse de la croissance économique ainsi que la montée du
chômage ont engendré une limitation des recettes qui remet en
cause en partie le système de financement de la protection
sociale. Les cinq dernières années ont connu des déficits
importants. La création de nouveaux impôts comme la
contribution sociale généralisée (CSG) en 1991, la hausse des
taux de cotisations liées à l'emploi salarié et leur
déplafonnement, la mise en place de cotisations sur certains
revenus de remplacement(1) ainsi que l'augmentation de leur taux
ont partiellement pallié les difficultés rencontrées.
Source : INSEE, Les revenus sociaux 1981
- 1996", Synthèses, n°14, Statistiques publiques,
1997.
(1) : Par exemple, les pensions de retraite
au-delà d'un certain seuil.
Document 4
Répartition des ressources de la protection
sociale de 1981 à 2001, en % (France).
| |
1981 |
1986 |
1990 |
1996 |
2001 |
| Cotisations Dont : cotisations employeurs cotisations salariés autres cotisations |
76,8 |
76,3 |
79,5 |
74,8 |
66,5 |
| Impôts
et taxes Dont : impôts et taxes affectés(1) autres contributions publiques(2) |
17,6 |
17,8 |
17,0 |
22,0 |
30,8 |
| Autres recettes | 5,6 |
5,9 |
3,5 |
3,2 |
2,7 |
| Total des ressources | 100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Sources : Comptes de la protection
sociale, TEF, Edition 2003.
(1) : Impôts et taxes automatiquement
affectés à la couverture des dépenses de solidarité (aide aux
chômeurs ne relevant pas ou plus des régimes d'assurance
chômage, RMI, aide sociale). II s'agit, entre autres, des taxes
sur le tabac, et depuis 1991, de la CSG.
(2) : Autres versements à partir du budget
de l'Etat destinés à équilibrer les comptes des régimes de
protection sociale.
Document 5
II y avait un statut de l'emploi qui
échappait largement aux fluctuations du marché et aux
changements technologiques et qui constituait la base stable de
la condition salariale. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus
à une fragmentation des emplois, non seulement au niveau
des contrats de travail proprement dits (multiplication des
formes dites "atypiques" d'emploi par rapport au CDI),
mais aussi à travers la flexibilisation des tâches de travail.
II en résulte une multiplication de situations de hors-droit, ou
de situations faiblement couvertes par le droit, ce qu'Alain
Supiot appelle "les zones grises de l'emploi" : travail
à temps partiel, intermittent, travail "indépendant"
mais étroitement subordonné à un donneur d'ordre, nouvelles
formes de travail à domicile comme le télétravail,
sous-traitance, travail en réseau, etc. En même temps le
chômage s'est creusé et les alternances de périodes
d'activité et d'inactivité se sont multipliées. Il semble donc
que la structure de l'emploi, dans un nombre croissant de cas, ne
soit plus un support stable suffisant pour accrocher des droits
et des protections qui soient, eux, permanents.
Source : Robert Castel, L'insécurité
sociale, Le Seuil, 2003.
Document 6 : Itinéraire
professionnel et pauvreté (France)
| ITINERAIRE PROFESSIONNEL | Niveau
de vie inférieur au seuil de pauvreté(1) (en milliers) |
Répartition
des travailleurs pauvres(2) (en%) |
| Indépendants toute l'année | 350 | 27 |
| Salariés
toute l'année Dont : CDI toute l'année à temps complet autres salariés en emploi toute l'année Par exemple : CDI à temps partiel CDD ou intérim |
510 270 240 106 83 |
39 21 18 8 6 |
| Emploi (dominant) et chômage | 175 | 13 |
| Chômage (dominant) et emploi | 179 | 14 |
| Avec période d'inactivité | 91 | 7 |
| Ensemble | 1305 | 100 |
Source : INSEE - DGI, Enquête Revenus
fiscaux 1996, Economie et statistiques n° 335, 2000.
Lecture : La modalité "emploi
(dominant) et chômage" regroupe les individus ayant été
toute l'année actifs, soit en emploi, soit au chômage mais plus
souvent en emploi qu'au chômage.
(1) : Le niveau de vie correspond à
l'ensemble des biens et des services qu'un individu peut se
procurer. L'indicateur de niveau de vie est souvent mesuré par
le revenu national par habitant, Le seuil de pauvreté est fixé
à 50 % du revenu médian.
(2) : La notion de travailleur renvoie ici aux individus de 17
ans ou plus, actifs au moins six mois entre avril 1996 et mars
1997, dont un mois en emploi effectif. Un travailleur est
qualifié de pauvre s'il appartient à un ménage dont le niveau
de vie est inférieur au seuil de pauvreté, fixé à 50% du
revenu médian par unité de consommation.
THEME DU PROGRAMME :
Intégration européenne et politiques économiques et sociales
I - LE TRAVAIL PRÉPARATOIRE
(10 points)
Vous répondrez à chacune des questions en
une dizaine de lignes maximum.
1. Quelles sont les critiques
formulées par les libéraux à l'encontre des monopoles publics
? (document 1) (2 points)
2. Présentez les arguments des
opposants à la réforme de La Poste ? (document 2) (2 points)
3. Exprimez la variation que traduit
la donnée entourée. (document 3) (1 point)
4. Expliquez l'évolution des
différents prix pratiqués par France Télécom depuis 2000.
(document 3) (2 points)
5. Commentez le passage souligné.
(document 4) (1 point)
6. En quoi la notion de service
universel est-elle différente de la notion classique de service
public en France ? (document 4) (2 points)
II - LA QUESTION DE SYNTHÈSE
(10 points)
Après avoir caractérisé l'évolution des
services publics dans les pays de l'Union européenne, vous
analyserez ses effets.
Document 1
En Europe, depuis la signature de l'Acte
unique, en 1987, au nom du respect de la concurrence, des pans
entiers des secteurs et services publics nationaux, gérés
jusque-là par la puissance publique, ont fait l'objet d'une
politique systématique de libéralisation, de privatisation et
d'ouverture à la concurrence, conduite par la Commission, avec
l'aval des gouvernements. Télécommunications et transports
aériens ont été les premiers concernés. L'énergie, les
transports ferroviaires et la poste sont actuellement passés au
tamis communautaire. Avec les services publics pour gros caillou.
En effet, les monopoles publics, qui constituent, notamment en
France, leur mode d'organisation traditionnelle, sont pour les
libéraux un obstacle évident à l'objectif de réaliser sans
entrave et dans le cadre du marché intérieur unique la libre
circulation des biens et services entre pays membres.
Source : Serge Marti, "Services publics
: la France peut-elle tenir tête à Bruxelles ?"
Le Monde, 4 juin 2002.
Document 2
La réforme de La Poste va-t-elle enflammer
avant l'heure la rentrée sociale ? La CGT est montée au front
hier en dénonçant, par la voix de la Fédération nationale de
La Poste et des télécommunications, "les orientations
libérales qui vont aboutir à une réduction du nombre de
bureaux et de salariés" de l'opérateur public sur le
territoire. Un cri d'alarme après la publication dans "Le
Parisien", d'un plan d' "évolution du
réseau" élaboré par la direction de La Poste prévoyant
"la disparition en trois ans de 6 000 des 11 500 bureaux
polyvalents". Ce chiffrage a plongé toutes les parties
concernées - syndicats, élus locaux, postiers - dans la
stupéfaction. [...] "Ce qui est vrai c'est que cela bouge
", a commenté hier [le ministre délégué à l'industrie],
tout en démentant formellement le chiffre de 6 000 bureaux
supprimés. Le ministre de l'industrie a rappelé la doctrine en
cours : transformer les bureaux non rentables "en points de
contact, c'est-à-dire en une collaboration avec la mairie ou un
café-tabac, un commerçant" offrant une "plage
d'ouverture qui est bien plus considérable".
Source : Joël Cossardeux et Renaud Honore,
"La restructuration du réseau postal s'engage dans la
controverse",
Les Echos, 20 août 2004.
Document 3
Évolution des prix des services de
télécommunication de France Télécom pour les ménages (base
100 : 2000)
| Années | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| Abonnement (1) | 100 | 104 | 106 | 108 |
| Communications locales | 100 | 95 | 95 | 95 |
| Communications longue distance | 100 | 88 | 88 | 88 |
| Communications fixe vers mobiles | 100 | 86 | 80 | 70 |
| Communications internationales | 100 | 93 | 93 | 93 |
Source : d'après l'INSEE et l'ART, 2004.
Note : tout abonné à un téléphone fixe
en France, est autorisé par décision de l'Autorité de
réglementation des télécommunications (ART), à choisir un
opérateur téléphonique autre que France Télécom depuis le :
- 1er Janvier 1998, pour les appels longue distance et
internationaux
- 1er novembre 2000, pour les appels d'un téléphone fixe vers
un mobile
- 1er janvier 2002, pour les appels locaux.
(1) Prix forfaitaire mensuel que tout usager
d'un téléphone fixe doit payer à France Télécom pour
l'acheminement des appels, l'entretien et l'extension du réseau
téléphonique.
Document 4
L'unique préoccupation (des services
publics) devait être d'accomplir la mission qui leur était
confiée avec régularité, exactitude, fiabilité, sans
s'interroger sur sa pertinence éventuelle ou sur son coût.
Cette conception est désormais obsolète ; le service public
est invité à tirer le meilleur parti possible des moyens
matériels et humains qui lui sont alloués [...]. Cette
évolution conduit à une réévaluation en profondeur de la
conception classique de service public. Positive dans le sens où
elle soumet les services publics à une contrainte permanente de
justification et les astreint à un effort continu d'adaptation,
elle pose cependant le problème [...] de services invités à se
plier à la loi de la concurrence et à s'inspirer des modèles
de gestion du privé.
Source : Jacques Chevallier, "Quel
avenir pour les services publics à la française ?",
La Découverte, 2003.
Corrigé
(source : Wanadoo)
I -L'ANALYSE DU SUJET
Le sujet porte sur une partie des effets de
la crise de l'emploi que connaît la France depuis 30 ans. Il
concerne le chômage et le sous-emploi dont l'actualité récente
a montré qu'ils constituaient une des principales questions
sociales actuelles. Les candidats ne devraient donc pas être
surpris.
Les documents donnent des éléments utiles et sans surprise
auxquels les candidats devront ajouter leurs connaissances.
Le sujet renvoie à deux parties du programme : travail et emploi
d'une part ; intégration et solidarité de l'autre. Il convient
donc de les mettre en relation.
II - UN TRAITEMENT POSSIBLE DU SUJET
INTRODUCTION
Depuis 25 ans, la fragilisation de la
Sécurité Sociale, des régimes de retraite par répartition et
des ASSEDIC a conduit à de multiples débats et à différentes
modifications dont la réforme Fillon des retraites votée par le
Parlement en 2003. L'emploi, et le chômage restent quant à eux
un problème récurrent que les gouvernements successifs
s'efforcent de solutionner ; ainsi le nouveau gouvernement
dirigé par D. de Villepin en a t'il fait sa priorité affichée.
Depuis le milieu des années 70, où il a
dépassé le cap des 500 000, le chômage s'est installé comme
une réalité massive et durable. La dégradation du marché du
travail est également perceptible dans le développement des
situations de sous-emploi (situation d'actifs travaillant moins
que ce qu'ils peuvent et veulent d'après la définition qu'en
donne le BIT) et par l'essor des emplois précaires (CDD,
intérim, stages...). Cela a atteint tant le niveau que la
pérennité des emplois et des revenus.
En quoi cela rejaillit-il sur le système de protection sociale ?
Ce dernier se définit comme l'ensemble des règles et des
institutions organisant la couverture collective des risques
sociaux et la redistribution. Pourquoi un marché du travail
dégradé induit-il une modification de l'organisation de la
protection sociale ?
Nous montrerons d'abord dans quelle mesure
les dysfonctionnements du marché du travail ont mis en
difficulté le système de protection sociale. Nous expliquerons
ensuite pourquoi et comment le fonctionnement du système de
protection sociale a évolué pour faire face aux nouvelles
réalités.
A - PREMIERE PARTIE : LA DEGRADATION DU
MARCHE DU TRAVAIL EST L'UNE DES CAUSES DES DIFFICULTES
RENCONTREES PAR LE SYSTEME DE PROTECTION SOCIALE
1. Le marché du travail est
fortement dégradé depuis une trentaine d'années
Malgré deux baisses passagères à la fin
des années 1980 puis à la fin des années 1990, le chômage
s'est installé de façon structurelle. Parallèlement, le
sous-emploi et la précarité sont devenus le lôt de nombre de
salariés. Les jeunes les moins qualifiés, beaucoup de femmes
rencontrent ainsi des difficultés à se stabiliser dans un
emploi durable et à plein temps. Les CDD, l'intérim, les
stages, le temps partiel subi ont progressivement fragilisé le
salariat en remettant en cause l'emploi "typique" de la
période fordiste (CDI durable et à temps plein) et en
multipliant des situations de droits affaiblis, parfois
qualifiées de "zones grises de l'emploi" (Document 5).
De nouvelles formes de pauvreté sont apparues parmi les
chômeurs mais aussi parmi les actifs occupés, on parle ainsi de
"travailleurs pauvres" (Document 6).
2. Cette dégradation de l'emploi a
atteint le fonctionnement du système de protection sociale à
plusieurs niveaux
Le système de protection sociale a d'abord
été victime d'une crise de financement liée à un "effet
de ciseaux" : les recettes baissent du fait du
ralentissement du rythme de la croissance économique et de la
montée du chômage au moment même où il faut augmenter les
dépenses destinées à pallier les effets sociaux de ces mêmes
problèmes. Cela entraîne d'inévitables déficits (Document 3).
Une crise d'efficacité vient se greffer aux difficultés
financières dans la mesure où une partie des populations
fragilisées par la nouvelle configuration de l'emploi passe à
travers les mailles du filet de la protection sociale. Tout le
monde n'est donc plus correctement protégé, des
"sans-droits" et des "fin de droits"
apparaissent (Document 2 et 5) mettant les travailleurs sociaux
en échec (Document 1).
Cette double difficulté quant au financement et à l'efficacité
a nourri ce que l'on peut appeler une crise de légitimité. Cela
a amené à s'interroger sur la nécessité de réformer un
système que les économistes les plus libéraux rejettent
globalement.
Il nous faut maintenant analyser comment le système de
protection sociale, considéré comme l'un des piliers du
"modèle social français", s'est adapté face à cet
ensemble de remises en question.
B - DEUXIEME PARTIE : LE SYSTEME DE
PROTECTION SOCIALE A EVOLUE POUR REPONDRE AUX EFFETS D'UN EMPLOI
DURABLEMENT DEGRADE
1. Le nouveau fonctionnement du
marché du travail a généré des problèmes auxquels le
système de protection sociale n'était pas préparé à
répondre
De nouveaux publics, chômeurs de longue (et
parfois de très longue) durée, travailleurs pauvres, jeunes en
mal d'insertion professionnelle, etc, se sont retrouvés
candidats à une prise en charge par la protection sociale
(Documents 1 et 6). Or, le système n'a pas été construit pour
celà.
Pensé et mis en place au lendemain de la 2e Guerre Mondiale, le
système de protection sociale est né dans le contexte d'un pays
en plein ralentissement et en pénurie de main-d'œuvre, le
financement comme l'accès aux droits ont été articulés autour
de l'emploi (fidèle en cela aux origines bismarckiennes du
système français).
Les cotisations sur les salaires étaient au cœur d'un
dispositif supposant un plein emploi durable (Document 3).Ces
modalités, anciennes, du financement rendent le système
inadapté aux transformations de l'emploi. Parallèlement, le
vieillissement de la population vient également perturber la
cohérence de ce système de protection sociale.
Les techniques classiques de l'Etat providence associant
assistance et assurance dans une logique de solidarité nationale
sont ainsi dépassées à partir des années 1980 (Document 3).
Cela ne pouvait durer sans modifications.
2. Le système de protection sociale
s'est modifié
Différentes réformes sont intervenues,
notamment en matière d'indemnisation du chômage (la
dégressivité est décidée en 1992), de financement de la
Sécurité Sociale (avec la création de la CSG puis de la CRDS),
des modes d'accès et de financement des retraites, ces nouvelles
mesures ont accompagné la hausse des cotisations sociales déjà
existantes (Document 3).
La création de nouvelles règles et de nouveaux dispositifs
comme le RMI (Revenu Minimum d'Insertion), ou la CMU (Couverture
Maladie Universelle) (Documents 3 et 4).
Les différentes modifications impliquent une inflexion déjà
significative du système :
- il donne une place croissante au financement privé et à une
logique assurancielle (poids des mutuelles dans le financement de
la santé, place de la capitalisation dans les retraites,
ouverture au privé du service de placement des chômeurs)
(Document1)
- une partie plus importante du financement est fiscalisée, ce
qui amoindrit notablement la part financée par les employeurs
(Document 4)
- l'accès aux aides sociales est de plus en plus diversifiée
entre les ménages (RMI, CMU, ASS pour les plus précaires)
(Document 2), ce qui permet de mieux particulariser la réponse
aux besoins, mais risque en même temps de creuser les
inégalités et les stigmatisations.
Il reste à savoir si la protection sociale et la redistribution
pourront toujours s'adapter aux nouvelles formes de précarité
et aux risques d'exclusion qu'engendre le fonctionnement actuel
du système d'emploi.
CONCLUSION
En dépit de déficits financiers et de
difficultés répétées, le système de protection sociale
français s'est modifié pour tenter de résoudre les déficits
auxquels l'a soumis la dégradation du marché du travail. Il a
évolué pour limiter les effets d'une précarité générant
pauvreté et inégalités.
Il semble pourtant difficile d'imaginer qu'ils puisse préserver
un lien social de qualité tant que le chômage et le sous-emploi
ne seront pas ramenés à un niveau plus limité évitant ainsi
que ne se creusent perpétuellement de nouvelles failles.
I - L'ANALYSE DU SUJET
Le sujet porte sur l'évolution des services
publics. Il s'agit d'une question centrale et actuelle dans les
débats sur la construction européenne. Ce thème est étudié
dans la dernière partie du programme de Terminale :
"Intégration européenne et politiques économiques et
sociales", dans le chapitre intitulé "Les nouveaux
cadres de l'action publique". Les documents proposés
permettent aux candidats de disposer de données analytiques et
factuelles. Il faudra cependant mobiliser des connaissances
personnelles pour traiter correctement le sujet et être clair
sur certaines notions (service universel par exemple) .
II - LE TRAVAIL PREPARATOIRE
Question 1 :
Les économistes libéraux sont opposés à
l'intervention de l'Etat dans la production de certains services
publics : transports, production d'énergie, par exemple. Ils
estiment que l'existence de monopoles publics tels que l'EDF-GDF,
la SNCF, la Poste, fausse la concurrence sur des marchés qui
devraient être "ouverts" à l'échelle nationale ou
européenne. En protégeant ainsi ces entreprises, l'Etat les
dispense de rechercher la plus grande efficacité. Soumise à la
concurrence, ces entreprises seraient, d'après les libéraux,
plus productives et plus performantes.
Question 2 :
Les syndicats de salariés comme la CGT sont
hostiles aux réformes jugées trop libérales de la Poste. Les
élus locaux les rejoignent souvent dans cette protestation. Les
uns et les autres estiment que l'évolution programmée du
secteur postal conduira à la fermeture de 6 000 bureaux de poste
et de nombreuses suppressions d'emplois, au nom d'une recherche
de rentabilité.
Question 3 :
Cet indice représente l'évolution du prix
d'un abonnement à une ligne téléphonique facturée par France
Télécom. L'indice est passé de 100 à 106 entre 2000 et 2002,
ce qui révèle une augmentation du prix de 6%.
Question 4 :
L'intérêt du document est de montrer que,
sous l'effet de la concurrence, les prix des communications
servies par France Télécom ont baissé depuis plusieurs
années. Baisse de 30% pour les communications "fixe vers
mobiles", de 18% pour les appels "longues
distances". L'arrivée de nouveaux opérateurs (Neuf
Télécom, Free, Cégétel) ainsi que l'essor de la téléphonie
cellulaire a incité France Télécom à adapter ses
tarifications. On note cependant une certaine compensation car
l'entreprise a augmenté le prix des abonnements de 8% entre 2000
et 2003.
Question 5 :
Cette phrase illustre l'orientation
souhaitée par les pouvoirs publics qui veulent soumettre le
service public à des obligations d'efficacité. On estime que
l'analyse des coûts de ces services n'était pas menée
clairement puisque les priorités étaient ailleurs (gratuité,
égalité dans l'accès aux services...). Il est convenu
désormais que le service public devra optimiser les moyens en
main d'œuvre et en matériel pour fonctionner. On se
rapproche ainsi des modes de gestion d'entreprises privées en
fixant des objectifs de productivité.
Question 6 :
La notion de service public renvoie à
quelques principes fondamentaux. Il s'agit d'activités souvent
peu rentables mais dont la réalisation est jugée indispensable
dans une société. Elles supposent donc une intervention
publique pour permettre un accès égal pour tous en cherchant le
plus possible la gratuité. La notion de service universel est
moins large. Elle est liée à la construction européenne et
elle suggère qu'au sein du service public, doit être garanti un
accès pour tous à certains services jugés essentiels, par
l'assistance ou la gratuité (énergie, eau, télécommunication,
transports). Le service public pourra ainsi être élargi à
d'autres missions (sans doute définies et financées autrement).
III - UN TRAITEMENT POSSIBLE DE LA
QUESTION DE SYNTHESE
L'évolution des services publics est au
centre des débats sur la construction européenne. Les
"non" français et hollandais au référendum sur le
projet de constitution européenne ont pu être interprétés
comme une méfiance des électeurs à l'égard d'une évolution
jugée trop libérale. L'influence du libéralisme se fait sentir
en Europe par les privatisations, la baisse des impôts ou encore
le recours à davantage de flexibilité sur le marché du
travail. Ces trois aspects sont indéniablement présents dans
l'évolution des services publics depuis la fin des années 80.
Il convient donc de présenter cette évolution pour ensuite en
mesurer les effets.
A - A LA FAVEUR DE LA CONSTRUCTION
EUROPEENNE, LES SERVICES PUBLICS CONVERGENT VERS UN MODELE PLUS
LIBERAL
1) Une politique d'ouverture à la
concurrence
Remise en cause des monopoles publics (document
1). Privatisations (France et Grande-Bretagne).
2) L'ouverture des frontières pour les
services publics
Recherche d'économies d'échelle. Volonté
d'élargir le marché et de favoriser la libre circulation des
biens et des services, conformément aux principes du
libéralisme (document 1) et de l'unification européenne.
Exemple: ouverture au privé du transport ferroviaire et du
courrier.
3) La notion de service public redéfinie
Volonté de maintenir une certaine
régulation pour des activités essentielles : on définit les
services "universels". Le périmètre classique des
services publics se voit donc modifié.
B - LES EFFETS DE CETTE EVOLUTION
1) Des effets positifs
Soumises à la concurrence, des entreprises
ont dû baisser leurs prix de vente (document 3). Un
effort de modernisation peut être relevé dans les services
publics (relations avec les usagers, qualité des prestations,
innovations...).
2) Cette évolution présente des limites
Suppressions d'emplois au nom d'une logique
de rentabilité (document 2). Flexibilité du travail
accrue pour les salariés du secteur public. Suppressions de
certains services jugés trop coûteux : Poste (document 2),
lignes ferroviaires. Efficacité incertaine suite aux
privatisations (exemple du chemin de fer en Grande-Bretagne).
3) Risque de remise en cause du lien
social
Les services publics créent du lien social
(égalité devant certaines prestations : culture, transports) et
contribuent à unifier le territoire. La fermeture de bureaux de
poste ou de lignes ferroviaires fragilise ou marginalise une
partie de la population.
CONCLUSION
On peut se demander si cette évolution des
services publics ne va pas provoquer des tensions au sein de la
population mais aussi des difficultés pour les entreprises. Le
service public génère des externalités positives d'après les
économistes. La logique de marché sera-t-elle à même de
remplir ces fonctions ?
[Accueil] [Notes de lectures] [Examens] [Lexiques] [Liens] [Statistiques] [Recherche] Plan du site [Archives] [Esprit Critique] [Trucs et astuces] [Création de site] ! Délire java ! Courriel :Sitécon
la copie est nécessaire le progrès l'exige.