NOTES DE LECTURES
René Mouriaux Le syndicalisme en France Que sais-je ?
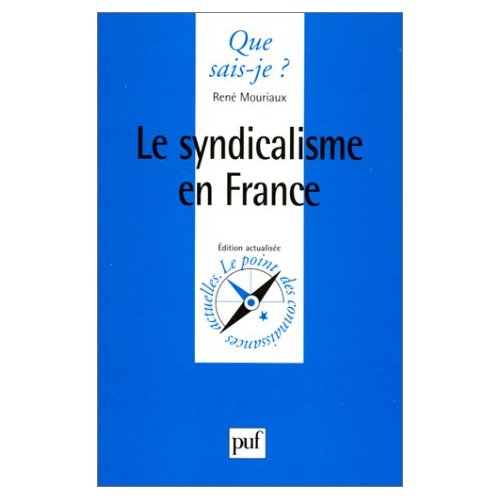
4 ème ed. corrigée : 1999, décembre PUF
Pourquoi ce livre ? parce que le syndicalisme est nécessaire dans le monde économique, politique et social. Face à la montée du libéralisme et de la mondialisation il est de plus en plus vital que les salariés, les travailleurs se regroupent pour se défendre face aux multiples agressions : esclavage, travail des enfants, précarisation, conditions de travail, rémunération, remise en causes de droits, etc. Pourtant le syndicalisme semble sur le déclin, c'est pourquoi il faut connaître son histoire pour pouvoir le faire évoluer, en particulier par des regroupements au niveau européen et mondial, puis par une redéfinition du rôle du syndicat et son élargissement aux travailleurs actuels et potentiels, comme les chômeurs !
Nous reviendrons sur ce sujet prochainement avec d'autres notes de lectures consacrées à Pierre Bourdieu et sans doute à Michel Onfray.
Généalogie / la FEN / Les jaunes / L'Europe /
IntroductionPREMIÈRE PARTIE LES FORCESChapitre 1 -Les origines Chapitre II - Les cinq grandes confédérations Chapitre III - Syndicalisme autonome et indépendantDEUXIÈME PARTIE LES PRATIQUESChapitre IV - La vie interne Chapitre V - L'action revendicative Chapitre VI - La négociation collective Conclusion Bibliographie indicative
Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Plusieurs sociologues ont repris l'image baudelairienne tour évoquer le comportement du syndicalisme français dans les années quatre-vingt-dix. Riche de traditions séculaires, alourdi par le poids des habitudes, l'albatros corporatif serait embarrassé pour adopter, une démarche neuve ou pour prendre un nouvel envol. Affaibli, divisé, contesté, le mouvement syndical en France est confronté depuis 1976 à une remise en cause. Travaillé par les transformations qui bouleversent la société en son ensemble, il traverse une triple crise. D'abord de représentativité. En vingt ans, les effectifs ont fondu de deux tiers. A lui seul le constat ne saurait justifier un refus patronal de reconnaître l'interlocuteur corporatif. Les élections professionnelles manifestent une audience plus large que l'adhésion. Le recul de la participation, la montée des listes " sans étiquette " dans les consultations pour les comités d'entreprise alertent sur la liaison entre syndicalisation et consécration électorale. L'affaiblissement numérique des organisations syndicales ne résulte pas seulement du chômage dont l'importance ne saurait être sous-évaluée, il provient d'un processus plus large. Des collectifs ouvriers importants ont été détruits. De nombreux fonctionnaires ont aussi cessé de cotiser. Le syndicalisme ne rassemble pas les sans-emploi, les travailleurs précaires, les salariés des PME. environ 8 millions et demi de personnes au total. En repli sur les terrains ensemencés, écartées de larges zones du salariat, les diverses composantes du mouvement syndical peinent à pénétrer les nouvelles couches techniciennes. Le second défi à relever par le syndicalisme concerne la stratégie. Dans la phase précédente, l'action collective s'inscrivait, mutatis mutandis, dans le cadre du compromis fordiste comportant un certain partage des gains de productivité sous forme de salaires direct et indirect, un développement du travail en miettes, une insertion dans une consommation de masse. La croissance s'effectue de manière autocentrée, dans le cadre national. L'épuisement du for- disme pousse à l'investissement dans des technologies sophistiquées, à l'internationalisation de la production. Le salariat se fragmente, se dualise. Les fonctions de l'Etat-providence se resserrent et se rétractent sous le double effet de la régionalisation et de l'européanisation des politiques économiques. Face à ces modifications, le mouvement syndical tâtonne. Les stratégies antérieures tombent en désuétude sans que se dessine avec netteté la figure de celles qui suivent. Rongé à la base, imprécis dans ses objectifs, le mouvement syndical est incertain sur sa conception. Le courant communiste est frappé de plein fouet par l'effondrement de l'URSS et du camp socialiste. Mal en point dans ses bastions, la social-démocratie est particulièrement affaiblie sous sa version française. La restauration entreprise par Jean-Paul II n'empêche pas le catholicisme social de demeurer fort atone. Pour le moins, les grands repères doctrinaux ne fonctionnent pas. Face au libéralisme apparemment triomphant, les oppositions sociales pâlissent. Intentionnellement nous avons utilisé le pluriel. Le syndicalisme est un terme générique, il recouvre des réalités diverses. Nous n'entendons pas ici imposer une bonne définition et écarter ce qui ne s'y conformerait pas. Certes, la loi de 1884 stipulait que " les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ". La formulation est légèrement modifiée en octobre 1982 : " Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des personnes visées par leurs statuts. " Intentionnellement, dans les deux énoncés, le législateur écarte de la spécialité de l'objet du syndicat la politique. L'approche scientifique ne saurait procéder à une pareille réduction normative. Toutes les formes du syndicalisme seront ici prises en compte, réformistes et révolutionnaires, confessionnelles et laïques, autonomes et confédérées, d'action directe, et proches des associations ou des groupes de pression. Une telle attention au polymorphisme relève-t-elle d'un agnosticisme peu syndical ou d'un plat positivisme ? Sachant que le social investit le chercheur lui-même, il s'agit d'une manière critique de pénétrer la matière, de la faire sienne, d'en construire la logique. Nous nous appuierons pour accomplir cette tâche sur les travaux déjà disponibles. La littérature consacrée au syndicalisme français est fort vaste. L'apport des historiens est considérable mais aussi des économistes, des juristes, notamment du travail; des sociologues, des politologues et même des linguistes. Phénomène multidimensionnel, le syndicalisme est étudié par plusieurs disciplines qui se rapprochent dès lors qu'on met en oeuvre une problématique de rupture avec le sens commun pour lequel l'apparence dévoile immédiatement la réalité. En un premier temps, nous considérerons le processus d'élaboration par lequel les forces syndicales sont passées et fournirons un panorama des organisations contemporaines. Nous examinerons ensuite les pratiques pour terminer par le pointage des questions les plus sensibles dans la période contemporaine..../...Anti-libéral, centré sur le secteur public, le mouvement social de l'automne 1995 qui n'a comporté chez les salariés aucune mise en place de coordination a été marqué par un double caractère, une puissante aspiration unitaire à la base et une division au sommet que l'absence de contre-proposition au plan Juppé a consolidée. En se retirant, la vague gréviste a accentué les contradictions antérieures au sein des centrales comme elle a réactivé les rivalités intersyndicales, tout en redynamisant les idées de solidarité, démocratie, de grève générale. Après cette mariée de vive-eau, le devenir du mouvement syndical insuffisamment renouvelé demeure crisique (ou critique), c'est-à-dire ouvert sur des possibles contraires..../...Réalisatrice d'une révolution exemplaire après l'anglaise du XV siècle et l'américaine de 1774, la France s'est aussi singularisée par une histoire sociale intense. Laboratoire de la lutte des classes, porté à privilégier la < phrase révolutionnaire " aux dépens de la théorie, le mouvement ouvrier, en général, et syndical, en particulier, cumule les paradoxes. La faiblesse des organisations se double d'une capacité de susciter ou d'accompagner les manifestations de masse. Si les déséquilibres provoqués par 1789 commencent à être amortis autour de 1875, la période de clandestinité qu'a traversée le syndicalisme de 1791 à 1884 imprégnera longtemps la mentalité et les pratiques des militants. Les prétendus intérêts communs Le décret du 21 août 1790 avait reconnu à tous les citoyens le droit de s'assembler et de former entre eux ales sociétés libres. Le décret d'Allarde en mars 1791 supprime les corporations. L'Assemblée constituante voie le 14 Juin de la même année la loi Le Chapelier qui prohibe l'association professionnelle. " ART. Il. - Les citoyens d'un même état et profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers d'un art quelconque ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés, des délibérations, former des règlements, sur leurs prétendus intérêts communs. " ART. VIII. - Tous attroupements composés d'artisans, ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie et du travail, appartenant à toute sorte de personnes et sous toute espèce de conditions convenues de gré à gré ou contre l'action de la police et l'exécution des jugements rendus en cette matière, ainsi que contre les enchères et adjudications publiques des diverses entreprises seront tenus pour attroupements séditieux et, comme tels, seront dissipés par les dépositaires de la force publique sur les réquisitions légales qui leur seront faites, et punis selon toute la rigueur des lois, sur les auteurs, instigateurs et chefs des dits attroupements et sur tous ceux qui auront commis des voies de fait et des actes de violence."L'affirmation de l'individualisme étatique, l'obsession du maintien de l'ordre inspirent le refus de " prétendus intérêts communs ". Entre la liberté d'association et celle du travail, l'arbitrage s'effectue en faveur de la seconde. Les relations entre maîtres et ouvriers relèvent de conventions libres d'individu à individu. Le Code pénal de 1810 prévoit des peines rigoureuses contre ceux qui contreviendraient à l'interdiction de " cesser en même temps le travail " et en particulier contre " les chefs ou moteurs " des délits. Les tribunaux se montrent d'ailleurs plus sévères envers les ouvriers qu'à l'égard des employeurs.Une classe minoritaire dangereuseSi l'on en croit le recensement de 1826, sur près de 32 millions d'habitants, 22 millions, soit les deux tiers, vivent du travail de la terre. Ce qui n'est pas encore désigné par la lexie " classe ouvrière " est composé d'ouvriers ruraux, de gens de métiers, de prolétaires d'usines ou manufactures. La faiblesse numérique des travailleurs de l'industrie, la fragmentation de cette population rattachée d'un côté à l'artisanat et de l'autre à la paysannerie n'empêchent pas la formation d'une unité dans la précarité du niveau de vie, dans la vulnérabilité à l'égard des crises, dans l'enfermement d'une condition sociale pour le plus grand nombre indépassable. Le sentiment de la dignité du travail est associé à la revendication politique de l'égalité. Le souvenir de la révolution, de Babeuf, le goût de l'indépendance et de la liberté sont très partagés. Lorsque Henri Heine décrit dans sa Lutèce la visite des ateliers du faubourg Saint-Marceau qu'il effectue en 1840, il est frappé par la littérature présente sur les établis, discours de Robespierre, pamphlet de Marat, histoire de Cabet, Conspiration pour l'égalité de Buonarroti, " écrits qui avaient comme une odeur de sang " . Rien d'étonnant à ce que la bourgeoisie considère avec inquiétude ces " classes dangereuses ", frondeuses, vindicatives, facilement inflammables.Les embryons d'organisationsPour se défendre contre les aléas de l'existence, en premier lieu contre les méfaits de la maladie, les ouvriers créent des sociétés de secours. Les unions fraternelles échappent à la prohibition de la loi Le Chapelier. Certes, les révolutionnaires entendaient instituer l'assistance publique, mais, comme le montre avec précision Bernard Gibaud, le temps et les moyens manquèrent pour la réalisation de leurs principes. Les activités d'entraide mutuelle, vivaces sous l'Ancien Régime, se prolongent. Elles sont régies par l'article 291 du Code pénal qui stipule l'agrément et le contrôle des statuts par l'administration. La tolérance sourcilleuse l'emporte à partir de la Restauration. Les mémoires de Jacques-Etienne Bédé, témoignage important sur les pratiques ouvrières du début du XIXe siècle, dépeignent avec habileté comment les ouvriers tourneurs en chaise de la rue de Cléry à Paris se dotent en 1820 d'une société de secours mutuel et comment ils mènent à côté une grève contre l'accroissement de leur charge de travail. La collusion entre les deux phénomènes, déniée dans ce cas, est assez fréquente. Les sociétés de secours servent souvent de base à l'action de résistance. D'où des dissolutions et des reconstitutions clandestines. Parallèlement aux réseaux de solidarité et à l'organisation de grève, des ouvriers participent aussi à la vie de sociétés secrètes, républicaines puis socialistes. Dès 1830, les disciples de Saint-Simon envoient des prédicateurs chez les ouvriers. Les émigrés allemands fondent à Paris en 1836 la Ligue des Justes (Bund der Gerechten). Signe et véhicule d'une effervescence sociale, une première presse ouvrière apparaît. L'aspiration à l'unité entre les métiers se renforce sous la Monarchie de Juillet. Le cordonnier Efrahem le proclame en 1833 dans la brochure De l'association des ouvriers de tous les corps d'Etat : " Si nous restons isolés, éparpillés, nous sommes faibles, nous serons donc facilement réduits et nous subirons la loi du maître. " Dix ans plus tard, Flora Tristan lance, presque dans les mêmes termes, un appel à l'Union ouvrière : " Isolés vous êtes faibles et tombez accablés sous le poids des misères de toutes sortes ! Eh bien sortez de votre isolement ; unissez-vous ! L'union fait la force. Vous avez pour vous le nombre et le nombre c'est beaucoup. "Réactivé par la crise de 1857-1858, le mouvement ouvrier français qui comprend un fort courant proudhonien participe à la fondation de l'Association internationale des Travailleurs en 1864. La Ire Internationale rassemble des partis politiques, des organisations professionnelles, diverses associations ouvrières (coopératives, mutuelles) et accepte des adhésions individuelles. Karl Marx élabore la " Résolution sur les syndicats " adoptée au Ie, Congrès de 1866 dont le texte connaîtra une large diffusion et la problématique exercera une influence au-delà même des rangs de ceux qui se désigneront comme marxistes : " Résolution sur les syndicats de l'Association internationale des Travailleurs (1866). " A) Leur passé. - Le capital est une puissance sociale concentrée tandis que l'ouvrier ne dispose que de sa force de travail. Le contrat entre le capital et le travail ne peut donc jamais reposer sur des conditions équitables, pas même être équitable au sens d'une société qui met d'un côté la possession des moyens matériels d'existence et de production et, du côté opposé, les forces productives vivantes. " L'unique puissance sociale du côté des ouvriers est leur masse. Cependant, la puissance de la masse est brisée par la désunion. La dispersion des ouvriers est engendrée et entretenue par leur concurrence inévitable. Les syndicats sont nés tout d'abord de tentatives spontanées de la part d'ouvriers pour supprimer ou, du moins, restreindre cette concurrence, pour arracher des conditions de travail contractuelles les élevant au moins au-dessus de la condition de simples esclaves. " C'est pourquoi l'objectif immédiat s'est borné aux revendications journalières, aux moyens de défense contre les empiétements incessants du capital, bref, aux questions de salaires et de temps de travail. Cette activité des syndicats n'est pas seulement légitime, elle est nécessaire. On ne saurait s'en dispenser tant que subsiste le mode actuel de production. Au contraire, il faut la généraliser en créant des syndicats et en les unissant dans tous les pays. " D'un autre côté, les syndicats, sans en avoir conscience, sont devenus des foyers d'organisation de la classe ouvrière, comme les municipalités et les communes du Moyen Age le furent pour la bourgeoisie. Si les syndicats sont indispensables pour la guerre d'escarmouches quotidiennes entre le capital et le travail, ils sont encore beaucoup plus importants en tant qu'appareils organisés pour hâter l'abolition du système même du salariat. " B) Leur présent. - Jusqu'ici, les syndicats ont envisagé trop exclusivement les luttes locales et immédiates contre le capital. Ils n'ont pas encore compris parfaitement leur force offensive contre le système d'esclavage du salariat et contre le mode de produc tion actuel. C'est pourquoi ils se sont tenus trop à l'écart des mouvements sociaux et politiques généraux. Ces derniers temps pourtant, ils semblent s'éveiller en quelque sorte à la conscience de leur grande tâche historique, comme on peut l'inférer, par exemple, de leur participation en Angleterre au mouvement politique le plus récent, de leur conception plus élevée de leur fonction aux Etats-Unis et de la résolution suivante que la dernière grande conférence des délégués des trade-unions a prise à Sheffield " Cette conférence apprécie tout à fait les efforts de l'Association internationale pour unir les ouvriers de tous les pays dans une fédération fraternelle commune, et recommande instamment aux différentes associations qui sont représentées à la conférence de devenir membres de cette organisation, convaincue qu'elle est nécessaire au progrès et au bien-être de la classe ouvrière tout entière. " C) Leur avenir. - En dehors de leurs buts primitifs, il faut que les syndicats apprennent à agir dorénavant de manière plus consciente en tant que foyers d'organisation de la classe ouvrière dans l'intérêt puissant de leur émancipation complète. Il faut qu'ils soutiennent tout mouvement social et politique qui tend à ce but. En se considérant eux-mêmes et en agissant comme les pionniers et les représentants de la classe tout entière, ils réussiront nécessairement à attirer à eux ceux qui se tiennent encore en dehors du syndicat. Il faut qu'ils s'occupent soigneusement des intérêts des couches ouvrières les plus mal payées, par exemple, des ouvriers agricoles, auxquels des circonstances particulièrement défavorables ont enlevé leur force de résistance. Il faut qu'ils inculquent au monde entier la conviction que leurs efforts, bien loin d'être égoïstes et intéressés, ont au contraire pour but l'émancipation des masses écrasées. "Les grèves illégalesSelon l'image chère à Jean-Noël Chopart, le XIXe siècle ouvrier est traversé par " le fil rouge du corporatisme ". La solidarité entre gens de même métier prend aussi la forme de la révolte. Lors de l'introduction des " mécaniques ", ceux qui sont menacés de chômage s'attaquent à la cause immédiate de leur malheur. Le " luddisme ", terme forgé probablement à partir du nom d'un ouvrier anglais, Ludham, qui prit la tête des premières manifestations de ce genre, fut pratiquer en France contre les métiers à tisser, les machines à fendre le bois, les presses mécaniques, les machines à vapeur. L'extension de l'industrie entraîne la disparition du bris des machines. En revanche, une forme d'action connue depuis les Pharaons s'affirme, la cessation du travail, quoique la loi de 1791 l'interdise. Les mémoires de Jacques-Etienne Bédé que nous avons déjà évoquées laissent entrevoir la manière dont se combinent une action publique et une concertation clandestine. En 1820, les maîtres de la rue de Cléry à Paris, désireux d'accroître leur profit en s'appuyant sur le nouveau régime de liberté du travail, n'hésitent pas à diminuer les salaires, à supprimer l'usage de fournir des outils et décident d'accroître la charge de travail. Corvée nouvelle, la manutention des billes de bois qui servent de matière première pour les chaises " exposait les ouvriers à recevoir des assauts terribles et à être fracturés des bras et des jambes ". Après avoir créé une société de secours, JacquesEtienne Bédé, le délégué à vie de la mutuelle, est chargé de réclamer la suppression des corvées pour les ouvriers à la tâche. S'ouvre un long conflit (10 mai -le' septembre 1820). Bédé s'applique à établir le bien-fondé des revendications et la correction des demandes ouvrières. Il met en valeur la solidarité dont font preuve les jeunes ouvriers qui abandonnent un temps la capitale afin de laisser l'emploi disponible aux pères de famille et aux anciens. Un atelier, celui de Mme Cornil, devient un " champ d'asile ", dans des conditions qui demeurent obscures. Bédé ne cache pas que des ouvriers acceptent de jouer le rôle de briseurs de grève. Il mentionne aussi deux personnages douteux, l'un qui informe la partie adverse des intentions des grévistes, l'autre qui cherche à dévoyer l'action entreprise. Ce dernier est qualifié de traître. Résolus mais attentifs à ne pas se mettre dans l'illégalité, dans l'ensemble unis, les ouvriers déplorent le comportement des patrons. Ils distinguent d'ailleurs entre les anciens maîtres attachés aux traditions de la corporation et les nouveaux mus par leurs seuls intérêts. La morgue des parvenus est soulignée, comme si le reniement des origines poussait à plus de dureté. Latente, la coalition patronale est contournée par des maîtres tourneurs qui ne respectent pas le lock-out décidé par l'assemblée des principaux marchands, fabricants. Orgueilleux, menteurs, sans scrupule, les meneurs du côté patronal recourent aux faux bruits comme l'annonce de la mort de Bédé ou aux provocations. Les pouvoirs publics sont présentés avec prudence. Les commissaires et le préfet de police apparaissent soucieux d'apaiser la querelle en octroyant des secours et en favorisant la suppression des corvées. L'intention des autorités demeure cependant inconnue à la plupart des maîtres. Poursuivis pour entrave au travail, dix ouvriers sont acquittés le 21 décembre 1820 mais ils sont condamnés en appel le 31 janvier 1821. Le sieur Bédé est gratifié de deux ans de prison. L'avocat général lui conseille de déposer un recours en grâce dont la femme d'un autre condamné, Maria Bicheux, se fera la zélée démarcheuse. Tous ces événements peuvent laisser penser que les camarades de Bédé sont des fidèles des Bourbons, attachés aux traditions du passé. L'absence de claires références politiques et religieuses dans le témoignage de Bédé incite à la circonspection. Rémi Gossez qui a édité le texte résume bien la complexité du conflit : " L'affaire tient de la querelle de famille dans le cadre traditionnel limité aux hommes du métier et exprime leur réaction, celle d'un corps d'Etat manuel, devant les spéculations de commerçants qui en font un conflit social, à la faveur d'une interprétation du droit postérieur à la Révolution mais antérieur au développement du machinisme. " Le récit de Jacques-Etienne Bédé, le plus ancien que nous ayons d'un arrêt concerté du travail, éclaire sur le jeu auquel les ouvriers doivent avoir recours. Malgré les vicissitudes de l'activité économique, les grèves sont relativement nombreuses sous la Monarchie de Juillet et sous le Second Empire. Variable, leur efficacité se manifeste surtout dans les moments de prospérité. La répression, dont les coalitions sont fréquemment l'objet, alimente une opposition à l'égard de la justice consacrée à la défense de la propriété et du droit patronal et de l'armée dont l'activité entre 1815 et 1870 est concentrée sur les conquêtes coloniales et le maintien de l'ordre.Les trois défaites du prolétariat françaisTrois soulèvements jalonnent l'histoire ouvrière au cours du XIXe siècle. Chaque fois, les forces militaires ont sévi avec brutalité. L'insurrection des canuts lyonnais les 21, 22 et 23 novembre 1831 ouvre le cycle de la contestation armée. Après avoir pris part à la Révolution de 1830, les ouvriers en soie, déçus par l'instauration d'un cens, sont accablés par la baisse du prix de façon. Ils réagissent en réclamant le tarif que les fabricants admettent et ne respectent pas. Le 21 novembre, les canuts se révoltent et les insurgés s'emparent de la ville en deux jours. Les victimes, civiles ou militaires, s'élèvent à 357. Ne sachant que faire de leur victoire, les canuts accepteront le retour des pouvoirs légaux et le tarif sera annulé. Episode singulier, l' " affaire de Lyon " est perçue dans toute sa dimension sur-le-champ. " La sédition de Lyon a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas ", commente Saint-Marc Girardin dans Le Journal des Débats du 8 décembre 1831. Les canuts récidiveront en 1834 avec leur slogan: " Vivre en travaillant ou mourir en combattant. " 342 morts et 600 blessés seront dénombrés. En trois journées de février 1848, les Trois Glorieuses, la Monarchie de Juillet est emportée, par les combattants de la réforme et par des socialistes, par des ouvriers et par des bourgeois. La Seconde République naît dans l'illusion de la fraternité, dans l'engouement pour le prolétaire " Chapeau bas devant la casquette, A genoux devant l'ouvrier. "L'oeuvre sociale du gouvernement provisoire est contrecarrée. Dénaturés, les ateliers nationaux sont fermés. Lors des journées de juin, le général Cavaignac brise la révolte populaire : 3 000 morts et 15 000 déportés sans jugement. La réaction aboutit à l'Empire autoritaire. Traumatisé, le mouvement ouvrier ne reprend son essor qu'à partir de 1860. Le Second Empire finit, comme il a commencé, par une parodie. Par colère nationale contre la défaite, par protestation contre la dégradation de sa condition de vie, le peuple parisien se soulève le 18 mars 1871 et proclame la Commune. Elle durera soixante-douze jours. Elle esquisse une politique d'inspiration socialiste. Karl Marx lui conférera le statut d' " antithèse de l'Empire ". Ver- sailles entend écraser l'expérience, anéantir l'espérance. 18 000 communards périrent dans les combats, 13 000 furent condamnés à la déportation ou à la prison, sans parler de ceux qui s'exilèrent. La troisième défaite du prolétariat français, selon le titre d'une brochure de Benoît Malon, met un terme à la pratique des barricades. Elle n'en imprègne pas moins la culture ultérieure du mouvement ouvrier. Au VIIIe Congrès de la CGTU, en 1935, un ancien combattant de 1871 peut encore communiquer son message aux délégués : " Mes bons amis, je vous apporte mon salut révolutionnaire, de communard, ils ne m'ont pas eu, les brigands ! "La transition vers la reconnaissance légale du syndicalismeDans la seconde période de son règne, Napoléon III a tenté, avec l'aide du groupe saint-simonisant dit du Palais-Royal et de son cousin le prince Napoléon, de conduire une politique sociale. Une délégation ouvrière est envoyée à l'Exposition universelle de Londres de 1862. Plus important, après la publication du Manifeste des Soixante qui plaide pour une expression électorale autonome des ouvriers, l'empereur rend légale, le 25 mai 1864, la coalition des travailleurs. En février 1868, une circulaire du ministère de l'Intérieur recommande aux préfets de tolérer les réunions de grévistes. Le 31 mars de la même année, Le Moniteur publie un rapport prônant la tolérance à l'égard des chambres syndicales que Napoléon III approuve. Influencés par l'exemple anglais, stimulés par le développement du capitalisme, les corps de métiers s'organisent en chambres syndicales ou en syndicats. La terminologie n'est pas davantage stabilisée que l'idée. Chaque " corporation " se dote d'une organisation de défense qui traite de ses préoccupations mais aussi des intérêts généraux des travailleurs. Une véritable floraison se produit à partir de 1867, principalement à Paris. Les ébénistes, les cordonniers, les typographes, les orfèvres se regroupent mais envisagent très vite des coordinations par branches professionnelles et localement sur une base interprofessionnelle. En 1870, une Chambre syndicale des Ouvriers chapeliers de France se constitue, bel exemple de solidarité verticale, et l'année précédente s'était formée la Chambre fédérale des Sociétés ouvrières de Paris qui manifeste un esprit d'entente horizontale, interprofessionnelle. L'ouvrier relieur Eugène Varlin (1839-1871) prend une part active à cette double structuration et soutient les grèves. Membre de l'AIT, il incarne le socialisme révolutionnaire de l'époque, qui lie progrès économique et liberté.A un ami rouennais, il écrit le 8 mars 1870: " Vous devez bien comprendre que nous ne pouvons rien faire comme réforme sociale, si le vieil état politique n'est pas anéanti. " Varlin fut fusillé à la fin de la Commune. Les massacres de mai 1871 désarticulent le mouvement ouvrier qui pourtant renaît très vite. En 1872, le gouvernement dissout le Cercle de l'Union ouvrière de Paris qui réunit quinze chambres syndicales. Hostile à la répression, Léon Gambetta entend favoriser l'expression corporative qui contribuera à la limitation des grèves par l'affirmation d'un ordre juste et libre. Il charge un journaliste, Joseph Barberet, d'organiser un rassemblement des chambres syndicales. Le Congrès de Paris tenu du 2 au 10 octobre 1876 est le premier congrès ouvrier de l'histoire française. Il fait preuve d'un réalisme dont la prudence confine à la peur d'inquiéter. Le syndicalisme de pacification sociale tel que l'envisageaient Gambetta et Barberet, le barberétisme comme on l'appela à l'époque, est contesté dès 1878 par la (ré)apparition d'un courant collectiviste animé par Jules Guesde. La radicalisation, au sens fort du terme, des congrès ouvriers, va entraîner leur division entre mutuellistes et collectivistes et parmi ces derniers entre guesdistes et possibilistes. Bernard Gibaud relèvera là un effet de la loi Le Chapelier : souci de la légalité au sein du courant mutuelliste et division des tâches. (La loi sur la mutualité n'interviendra qu'en 1898 et celle sur les associations en 1901. L'interdit associatif de 1791 n'est surmonté qu'au prix d'une fragmentation du mouvement social.) Les confrontations au sein du mouvement ouvrier ne ralentissent pas l'essor du syndicalisme. C'est le moment où les républicains jugent nécessaire de légaliser les groupements professionnels. La loi du 21 mars 1884, fruit de huit années de débat, abroge la loi Le Chapelier et les articles du Code pénal napoléonien contre les coalitions.La loi de 1884 et ses effetsOutre la spécialité de l'objet que nous avons évoqué dans l'introduction et qui avait pour objectif d'empêcher une éventuelle dérive politique, le texte de 1884 définit le principe de regroupement. " ART. 2. - Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés, pourront se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement. " La loi accorde aux syndicats professionnels le droit d'ester en justice et leur reconnaît la possibilité de se coordonner en unions. Obligation est faite aux syndicats de déposer leurs statuts et d'indiquer les noms des responsables qui devront être français et jouir de leurs droits civils. Une partie des militants est opposée à ces dernières dispositions et sur la base des données publiées dans l'Annuaire des Syndicats pro- fessionnels de 1890, un ralentissement des créations s'observe dans les années qui suivent immédiatement la promulgation de la loi. La marche en avant reprend cependant très vite. Une Fédération nationale des Syndicats est créée à Lyon en octobre 1886. Sa structure comporte trois niveaux. Des conseils fédéraux locaux sont constitués dans chaque ville ou agglomération de communes avec un minimum de cinq syndicats. Un échelon régional est prévu par regroupement de dix départements. Enfin, le Conseil général fédéral comprend un délégué par département au rôle ainsi défini par les statuts " ART. 13. - Les délégués au Conseil général fédératif sont chargés de rechercher et d'étudier toutes les mesures d'ordre public qui peuvent intéresser les travailleurs, telles que les lois à abroger, abus de pouvoirs, monopoles non justifiés, etc., et de faire parvenir à tous syndicats un avis sur l'urgence de prendre des mesures dans un sens indiqué ou motivé par l'avis, de présenter et défendre, s'il y a lieu, les décisions prises par les syndicats. Enfin, suivant les circonstances, faire un appel général ou régional aux membres de la Fédération, pour trancher les difficultés qui pourraient surgir. " La vie interne de la FNS sera assez agitée. Au départ, elle est marquée par l'opposition entre barberétistes et guesdistes puis par la confrontation entre guesdistes et partisans de la grève générale. A partir de 1892, elle est concurrencée par la Fédération des Bourses du Travail. La loi du 5 avril 1884, communément appelée charte municipale, permet aux initiatives locales de se déployer. Dans ce contexte, le Conseil municipal de Paris prend l'initiative, en 1886, de créer une Bourse du Travail. L'exemple est imité par Nîmes, Marseille, Saint-Etienne, Toulon, Béziers, Montpellier, Sète, Lyon, Bordeaux. Les autorités municipales entendent mettre à la disposition des chambres syndicales des bureaux, des salles de réunion, une documentation. L'aide ainsi apportée n'est pas indemne d'arrièrepensées. Il s'agit de modérer le syndicalisme, de (intégrer au moins partiellement dans l'appareil d'Etat ou d'assurer sa liaison avec le parti politique qui dirige la municipalité. Le calcul sera, en partie, déjoué par les militants attachés à l'indépendance syndicale et à la lutte revendicative. La conception syndicaliste des Bourses du Travail leur assigne une quadruple tâche. D'organisation d'abord. La Bourse, intercorporative, a pour mission d'implanter partout les syndicats. Soucieuse de la solidarité, elle doit irradier dans le milieu ouvrier à travers des coopératives et des mutuelles, des services de placement et des aides aux travailleurs itinérants (viaticum). Des cours, généraux et professionnels, soutenus par la constitution de bibliothèques, sont destinés à élever la culture et la conscience des syndiqués. Enfin, collectrice d'éléments statistiques, la Bourse est un foyer de lutte. Elle aide les grèves partielles et prépare la grève générale qui entraînera la révolution et l'émancipation des travailleurs. Le mouvement des Bourses se structure en 1892 à travers la Fédération des Bourses du Travail de France et des colonies. Le Comité fédéral comprend un délégué par Bourse adhérente. Il désigne un bureau de quatre membres. L'organisation prévue par les statuts est donc fort simple. Malgré l'attachement profond au fédéralisme, la FBd'r est animée de manière personnelle par son secrétaire Fernand Pelloutier dont l'autorité ira croissant. Les anarchistes qui ont été écartés de la II, Internationale en 1896 et sont en difficulté après la phase des attentats (1892-1894) s'investissent dans le mouvement syndical. Préoccupé de trouver un abri et de s'assurer un moyen de recrutement, ils renforcent le pôle anti-guesdiste. Un certain nombre d'entre eux se prend au jeu et contribue à l'émergence d'une idéologie originale, le syndicalisme révolutionnaire. La rivalité entre la FNs et la Fédération des Bourses est mal vécue par la base. Un processus de rapprochement entre les deux organisations est engagé dès 1893 et il aboutit deux ans plus tard par la constitution de la première centrale syndicale de France, la Confédération générale du Travail.Tableau des dirigeants syndicaux de 1886 à 1895 FNS 1886 Chavrier 1887 Jean Dormoy 1888 Raymond Lavigne 1890 Alfred Delcluze 1892 Jean Coulet 1895 Etienne Pédron FBdt 1892 Bernard Besset 1893 Rieul Cordier 1895 Fernand Pelloutier.../... Généalogie
la FEN / Les jaunes / L'Europe / Conclusion
.../...La première Association des Anciens Elèves de l'Ecole normale de la Seine apparaît en 1882. Cinq ans plus tard, Eugène Spuller, ministre de l'Instruction publique, condamne avec la plus extrême fermeté la formation d'une Union des Instituteurs et Institutrices de la Seine. Le refus de reconnaître le droit aux fonctionnaires de bénéficier des dispositions de la loi de 1884 est justifié au nom de trois considérations. Tout d'abord, les pouvoirs publics ne sauraient admettre que se forme un contre-pouvoir face à la hiérarchie administrative légalement constituée. Ensuite, l'association des diverses sociétés corporatives aboutirait à la création d'une "grande force sociale capable d'être à certains moments une grande force électorale". Enfin, si le salaire des ouvriers est débattu de gré à gré entre le patron et ses employés, les traitements des fonctionnaires sont fixés par la loi et ne peuvent être modifiés que par elle.Les enseignants se soumettent à l'interdit de la circulaire ministérielle bientôt renforcée par un avis du Conseil d'Etat. Ils se regroupent en des associations tolérées, voire favorisées par l'administration. En 1905, des militants transgressent la volonté gouvernementale et lancent un " Manifeste des Instituteurs syndicalistes " qui incite à rejoindre la CGT. La contestation ne porte pas seulement sur la faiblesse des traitements qu'un Ferdinand Buisson a bien mis en évidence mais sur le contenu des programmes, sur la fonction sociale assurée par l' " enseignement officiel " à laquelle ils opposent le principe d'autonomie et le fédéralisme. Georges Cle- menceau en prononçant des révocations essaie de tuer le mouvement. Il survit cependant et se dote d'un journal en octobre 1910, L'Ecole émancipée.Les répressions et les hésitations du corps enseignant dont une partie est attachée à l'amicalisme confèrent une portée limitée à la seconde tentative de syndiquer la fraction républicaine, laïque, radicale et socialiste de la fonction publique. En raison de la part qu'ils ont prise à la guerre de 1914-1918 et du lourd tribut qu'ils ont consenti à la nation, les instituteurs créent un Syndicat national en 1920 sans être inquiétés. La tolérance obtenue en 1924 favorise la diffusion de l'expression corporative dans tous les ordres de l'enseignement. Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignants hésitent entre l'autonomie et la confédéralisation et lorsqu'ils optent pour cette dernière ils se divisent entre la CGT adoptée majoritairement et la CGTU choisie par une minorité composite. La Fédération unitaire de l'enseignement comprenait des syndicalistes révolutionnaires de L'Ecole émancipée, des trotskystes et des communistes. A l'instar de l'ensemble du mouvement syndical, le processus d'unification se produit aussi chez les enseignants. La FUE rejoint la Fédération générale de l'enseignement CGT. L'entente reste limitée. En particulier, les réformistes animés par André Delmas sont portés à soutenir des positions pacifistes extrêmes alors que les communistes unitaires combattent les accords de Munich. Le pacte germano-soviétique achève de délabrer l'unité rétablie en 1935 chez les enseignants. A la Libération, la FGE où les rapports de force entre courants ne se sont guère modifiés se transforme en Fédération de l'Education nationale. La nouvelle dénomination vise à marquer une évolution vers une fédération d'industrie. La FEN mène alors un triple combat, pour le reclassement des enseignants, pour l'essor de l'Education nationale sur la base du plan Langevin-Wallon (19 juin 1947), pour la défense de laïcité scolaire. Elle travaille aussi au développement du réseau, notamment par la création de la Mutuelle générale de l'Education nationale. Lorsque la scission de la CGT se produit, la FEN, en conséquence du choix effectué par sa principale composante le SNI, se prononce pour le passage à l'autonomie. Certes, une FEN-CGT se constitue avec les enseignants du technique, une FEN-Fo aussi avec ceux de l'Association française pour la Promotion des Adultes. (Ces structures changent leur dénomination pour devenir respectivement Fédération de l'Enseignement, de la Recherche et de la Culture (FERC-car) au début des années quatre-vingt et Fédération nationale de l'Enseignement et de la Culture (FNEC-FO) au début de, années soixante-dix.) L'essentiel des forces se retrouve dans une organisation unitaire certes, mais sans référence confédérale. Les socialistes et les syndicalistes révolutionnaires de L'Ecole émancipée ont conjugué leurs affects contre les communistes favorables à la CGT et majoritairement décidés à accepter une décision que beaucoup jugent provisoire. Dans les années contiguës à la scission confédérale, des militants de la FEN " autonome " pratiquent la double affiliation, les uns avec la FEN-CGT, les autres avec la FEN-FO. La double appartenance est abolie en 1954 par une décision du bureau politique du Pc h rapidement imitée par le bureau confédéral de Fo. La pérennité de l'autonomie est en voie de devenir un fait établi, d'autant que la majorité socialisante de la fédération a dès 1949 imposé l'homogénéité de l'exécutif. La FEN accroît ses effectifs, le courant majoritaire améliore ses scores. L'expansion scolaire sous la V' République apporte son lot d'épreuves. La FEN ne parvient pas à empêcher la concrétisation de la loi Debré en faveur de l'enseignement privé. Pendant la guerre d'Algérie, le courant majoritaire se fragmente et hésite. La dilatation du système scolaire modifie les équilibres internes. Le comportement hégémonique du SNI est mal supporté. Georges Lauré, secrétaire général de la Fédération, démissionne en septembre 1966 pour alerter sur l'urgence de rénover la vie fédérale. La mise en garde du second secrétaire général de la FEN ne suffit pas. Le Syndicat national de l'Enseignement secondaire (sNEs) est conquis en 1967 par le courant Unité et Action, continuateur de la tendance cégétiste. La forte mobilisation des enseignants pendant le mouvement de mai-juin 1968 ne trouve pas les dirigeants de la F EN totalement au diapason. Le Syndicat national de l'Enseignement supérieur (sNE-Sup) et le Syndicat national des Chercheurs scientifiques (sNCS), après avoir eu une direction gauchiste, se dotent d'une direction Unité et Action. Un nouveau courant " Rénovation syndicale " apparaît, réunissant diverses minorités, militants du Parti socialiste unifié (psu), maoïsants. Les responsables du courant majoritaire décident d'inverser le cours des choses. En 1971, le courant se réorganise et prend pour dénomination Unité, Indépendance et Démocratie. Le 11 mai 1973, le Ps organise une journée d'études à Clichy qui aboutit à la consigne, pour les enseignants socialistes, de rejoindre tous le courant UID. En 1975, une réforme de structure assure un meilleur contrôle de la direction fédérale sur les sections départementales. Comme les cinq centrales représentatives, la FEN reçoit des crédits du ministère du Travail pour la formation de ses militants à partir de 1976. La contre-offensive de la majorité socialiste au sein de la FEN s'avère d'autant plus efficace que le courant Unité et Action se trouve à son tour en difficulté avec la rupture de l'union de la gauche et les soubresauts qui affectent les pays communistes. L'avènement du gouvernement Mauroy calme le jeu. La FEN se rapproche même de la CGT en 1982 contre l'austérité. La majorité fédérale va cependant se plier à la rigueur salariale. Elle essuiera un grave échec pour son projet d'unification des deux réseaux scolaires, d'autant plus grave que la loi sur la régionalisation est adoptée. Une scission l'affecte. Des militants du courant Front unique ouvrier quittent la fédération pour constituer des syndicats concurrents à Force ouvrière en 1983. Les effectifs du sNi reculent alors que ceux du SNES se stabilisent. Les motifs d'inquiétude s'accumulent pour la majorité fédérale. Jean-Pierre Chevènement énonce l'objectif de 80 % d'une tranche d'âge au niveau du baccalauréat. La croissance à venir du système scolaire bénéficiera au secondaire et au supérieur. Le primaire, compte tenu des évolutions démographiques, est destiné à plafonner. Tenant compte de l'échec du gouvernement socialiste remplacé par la droite en 1986, jugeant que l'heure est sonnée de s'accaparer les dépouilles du courant communiste condamné par le naufrage de l'l'RSS, le courant Unité, Indépendance et Démocratie envisage la recomposition syndicale, la constitution d'un grand pôle réformiste avec la CFDT et Fo. Le projet se heurte au refus de Fo qui choisit Marc Blondel en 1989 et aux résistances internes. La FEN expulse de ses rangs le sNes et le SNEP en octobre 1992. Mal conduite, l'opération bénéficie aux opposants, regroupés au sein d'une Fédération syndicale unitaire (Fsu) fondée en avril 1993 et majoritaire aux élections professionnelles de décembre. En pointe dans la lutte contre la loi Bayrou le 16 janvier 1994 contre le CIP, la Fsu prend une part active au mouvement social de 1995. Elle se situe en tête du scrutin de décembre 1996 aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. L'ascension de la Fsu rencontre un premier frein avec des tensions internes provoquées par son syndicat du technique, le SNETAA, dont la culture héritée d'UIL) est fréquemment révulsée par la dominante Unité et Action et l'influence de l'Ecole émancipée. Ministre de l'Education sous la gauche plurielle, Claude Allègre, tout en dénonçant la cogestion qui se serait établie sous François Bayrou, s'ingénie à dresser le SNUIPP contre le SNES, à opposer une coalition SE FEN - SGEN CFDT contre le syndicat du secondaire de la FSU. Dans le mouvement des enseignants de la Seine-Saint-Denis au printemps 1998, l'alan de la fédération s'avère émoussé et les affrontements internes conduisent Michel Deschamps à démissionner le 11 mars 1999. II est remplacé le 7 avril par Monique Vuaillat et Daniel Le Bret. .../...Avant de traiter du syndicalisme " indépendant " , "<i retour en arrière s'impose. Dans le cas français, il n'est pas exagéré d'avancer que le syndicalisme est lié à gauche, avec la multiforméité que cette dernière comporte. Des réactions se sont produites contre cet état de fait. Contre les " rouges ", la première concurrence d'importance provient précisément des jaunes ". Le mouvement naît en 1899 au Creusot et à Mont- ceau-les-Mines. Des mineurs créent un syndicat indépendant. La diffusion du modèle permet en 1901 la création d'une Union fédérative des Syndicats et Groupements ouvriers professionnels de France et des colonies. L'organisation reçoit l'appui du patronat, d'hommes politiques comme Jules Méline, Emile Loubet, Président de la République, d'intellectuels tels Jules Lemaitre et Barrès, d'ecclésiastiques. Le 1- Congrès national des jaunes de France, dénomination qui s'est finalement imposée, réuni en 1902 à Saint-Mandé rassemble 203 délégués de 201 745 syndiqués (100 000 en réalité). Les responsables sont dynamiques, Paul Lanoir, des chemins de fer, Pierre Bietry, des mineurs. Leur mésentente se traduit très vite par une scission. Paul Bietry qui surmonte l'épreuve avec l'aide de Gaston Japy se fait élire député en 1906. Il quitte l'organisation syndicale en 1908 et dès 1909 la Fédération des jaunes commence à dépérir. Abandonné par la droite radicale et par la droite modérée, le mouvement s'efface l'année suivante, comme une création artificielle peut le faire, construite sur le sable des illusions et des faux- semblants. " Jaunes " : le mot, infamant, ne parvient pas à s'imposer en positif par un retournement volontariste. Les partisans du mouvement se réfèrent souvent au papier de couleur jaune qui avait remplacé les vitres brisées par les rouges du premier local à Montceau. D'autres évoquent la fleur de genêt que les militants fixaient à leur boutonnière. Ces explications de circonstance ne suppriment pas l'origine adverse, l'imputation par les cégétistes de cet adjectif dévalorisant, annonciateur de traîtrise, de parjure. Maurice Tournier estime que, pour une petite part, l'échec des jaunes provient de la dénomination qu'ils ont choisie. " Contradiction symbolique d'ouvriers anti-ouvriers, de rejetés rejetants, ils se sont empêtrés dans leur propre toile " (Mots, n° 8, mars 1984). Les tensions de l'idéologie jaune interviennent aussi dans son effondrement. D'un côté, comme le montrent Les Cahiers de l'ouvrier rédigés par Théophile (1904), le réformisme prôné s'attache aux différentes formules d'amélioration de la condition ouvrière, coopérative de consommation, jardins et logements, participation au bénéfice et au capital. De l'autre, l'anti-socialisme, l'anti-marxisme, l'antiinternationalisme prennent une telle place dans le discours jaune que les objectifs visés sont noyés dans un libéralisme intégral. Autre manière d'énoncer la contradiction :les jaunes se réclament de l'apolitisme populiste et s'inscrivent dans la stratégie de la droite prolétarienne. La place des syndicats jaunes est reprise en 1910 par une Union professionnelle des Syndicats libres à l'existence également éphémère. En 1918, elle se transforme, sans plus de succès, en Confédération nationale du Travail. Une Union générale des Syndicats réformistes se créé en 1920..../...La construction d'un espace social à l'intérieur de la Communauté économique européenne est une option qui n'est pas partagée par les douze membres. La Grande-Bretagne en 1991 a refusé tout accroissement des prescriptions contenues dans le traité de Rome et l'Acte unique. Si la voie réglementaire en matière sociale est facilitée par l'annexe du traité de Maastricht pour onze pays, elle laisse place à une démarche contractuelle qui comporte trois registres. D'abord au niveau central. La Confédération européenne des Syndicats, à laquelle sont affiliées la CFDT, F'o et la CFTC dialogue à Val-Duchesse depuis 1986 avec l'Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe (UNICE) et le Centre européen de l'Entreprise publique (CEEP). De ces rencontres sont sortis des " avis communs ", sorte de documents programmatiques, sur la stratégie de coopération pour l'emploi et la croissance (1986), les nouvelles technologies, la formation, l'information et la consultation (1987), le rapport économique annuel (1987), la formation et l'éducation (1990), les perspectives du marché de travail (1990) et un accord sur le rôle des partenaires sociaux dans la dimension sociale du Marché intérieur (1991). Une négociation sectorielle européenne s'amorce. Le VII' Congrès de la CES (1991) a renforcé le rôle des Comités syndicaux européens qui ont en charge un secteur d'activité économique. L'agriculture l'élevage fournissent un exemple d'entente européenne: sur la durée du travail. Un accord semblable avait é obtenu dans les transports : le règlement adopté par le Conseil des ministres s'en est écarté. Un accord européen sur la formation professionnelle dans le secteur du commerce de détail a été conclu le 19 octobre 1988. En 1991, on compte neuf branches doté de comités paritaires et seize autres procédant à des rencontres informelles tripartites. Le 14 décembre 1995, un accord-cadre sur le congé parental a été signé entre la CES, l'UNICE et le CEEP. Le document sympathique mais peu contraignant pour le patron a été suivi de deux autres sur le travail à temps partie (6 juin 1997) et sur le travail à durée déterminée (14 janvier 1999) qui relèvent assurément de la flexibilisation du droit du travail. Un troisième niveau de négociation européenne, ci, tout cas de concertation, est apparu dans des groupe multinationaux. La directive communautaire dU 22 septembre 1994 prévoit la constitution de Comité: d'entreprise européens, ce qui devrait concerne 122 entreprises françaises.Efficacité syndicale et compromisLe refus du compromis traduit l'incapacité syndicale de s'adapter. L'incapacité de s'adapter nourrit la crise du syndicalisme. Le refus du compromis nourrit la crise du syndicalisme. Sous diverses formes, nous avons entendu depuis dix ans ce syllogisme qui fonde a contrario la proposition :l'acceptation du compromis sortira le syndicalisme de sa crise. Le raisonnement n'est pas sans rappeler celui dont Montaigne invite à se méfier dans ses Essais (I, XXVI) : " Manger du jambon fait boire, le boire désaltère ; par quoi manger du jambon désaltère. " La notion d'adaptation est en elle-même assez molle. Elle renvoie à la conception d'un acteur relativement autonome dont le comportement est invité à se modifier en raison d'une évolution de son environnement. En réalité, le mouvement syndical français est confronté à une transformation de sa base sociale et à un changement profond de l'univers économique. Pour dire vite, le compromis fordiste s'est délité. Quelle réponse apporter à la crise économique ? Cette question se subdivise en d'autres interrogations : de quelle marge économique dispose la France ? Est-il possible de l'accroître ? Qu'est-ce qu'une revendication légitime ? Faut-il hiérarchiser les revendications et qui est en droit de le faire ? Comment faut-il défendre les acquis ? Quelle place tient la proposition économique dans la démarche revendicative ? Qu'estce qu'un bon compromis ? Lorsque le grain à moudre diminue, les salariés s'écartent d'un syndicalisme perçu comme inefficace. S'il concède trop au patronat, son < réalisme " le dessert. Le syndicalisme est au rouet s'il ne parvient pas à articuler mobilisation et négociation, critique sociale et solution tangible..../...Longtemps hanté par la Révolution française, marqué par trois défaites sanglantes (1831, 1848, 1871), le mouvement ouvrier français s'est singularisé par une composante syndicale qui a récusé majoritairement le modèle social-démocrate et le trade-unionisme. Le rôle prépondérant du syndicalisme révolutionnaire puis du courant communiste se perçoit et se construit à travers un long cortège de luttes revendicatives et de grèves générales. L'hégémonie des pratiques con- flictuelles n'a pas empêché, elle a favorisé même, par réaction, l'apparition de forces concurrentes sur une base confessionnelle ou catégorielle. L'intrication entre le champ partisan et le champ syndical provoque des scissions (1921, 1939, 1947) ou des réunifications qui dépassent souvent le cas français. En dehors de périodes fusionnelles où mobilisation et adhésion coïncidaient (1919, 1936, 1944 et dans une mesure beaucoup plus faible 1968), le syndicalisme français n'a jamais organisé qu'une minorité des salariés. Des sociologues ont même érigé le taux de 20-25 % en norme. Un certain élitisme qui préside à la phase de constitution, la pluralité organisationnelle à partir de 1919-1921, les règles admises par le patronat et les pouvoirs publics ont contribué à la faiblesse de la syndicalisation qui a été expliquée par l'individualisme de la culture nationale. La crise économique n'a pas ébranlé l'édifice syndical comme en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Elle l'a violemment démantelé. Pertes de syndiqués, de militants, de permanents, d'électeurs, diminutions des grèves et des manifestations. Selon des rythmes distincts, chacune des composantes du mouvement syndical français est touchée par la récession organisationnelle. Aucune famille idéologique n'est épargnée, laïque ou confessionnelle, réformiste ou révolutionnaire, catégorielle ou interprofessionnelle. Les dénégations n'ont pas manqué. La CGT a refusé l'expression de " crise syndicale " de 1980 à 1991. La CFDT l'a admise très tôt pour justifier son recentrage. La récusation volontariste comme la lucidité tactique n'ont pas mis à l'abri d'un dépérissement dont l'interprétation reproduit les lignes de clivage internes au mouvement syndical. Sans entrer dans les discussions techniques - un syndiqué se définit-il par l'achat de 8, 10 ou 12 timbres mensuels ? - un ordre de grandeur est énonçable. En vingt ans, le mouvement syndical a perdu plus de la moitié de ses cotisants. De 20 % en 1974, le taux de syndicalisation est passé en 1991 à moins du 10 %. Les estimations varient entre 7 et 9 %. La comparaison avec le syndicalisme des autres pays européens place la France dans la position de lanterne rouge. Alerter sur les différences des incitations à se syndiquer qui existent selon les types de syndicalisme - la France ignore le closed-shop, le check-off et ne dispose guère de services fournis aux seuls adhérents - ne supprime pas la pertinence du constat alarmiste sur l'état de ses organisations syndicales. Le chômage, les privatisations, la déréglementation (le démantèlement du droit du travail) concourent à l'affaiblissement du syndicalisme qui ne parvient pas à se renouveler. Les facteurs externes de destructuration forment système avec les causes internes d'épuisement. Patents, les maux dont souffrent les syndicats français sont cumulatifs. Moins d'adhérents entraîne une diminution du nombre de militants qui, à son tour, conduit à une diminution des effectifs. La réduction des moyens financiers provoque une capacité d'intervention réduite qui amplifie la désaffection. En période de crise, selon une remarque de Hegel, l'état du monde n'est pas encore connu. C'est pourquoi, plus encore que dans d'autres temps, les interprétations illusoires fleurissent, les démarches à contretemps abondent. Si l'on s'applique à dépasser les explications immédiates, unilatérales et descriptives - le syndicalisme français meurt de la montée de l'individualisme, de sa politisation, etc. - on perçoit qu'il est confronté à deux grands défis. D'une part, il est sommé d'exprimer le salariat tel qu'il est, dans sa diversité, dans sa complexité. Or le mouvement syndical français reste attaché aux figures du compromis fordiste, avec l'ouvrier qualifié et l'ouvrier spécialisé, l'employé de commerce et de banque, le fonctionnaire de l'Etat keynésien. La crise économique a non seulement diminué l'importance numérique de ce qui a pu être présenté de manière mythologique comme des bastions syndicaux, elle a engendré une zone de désert syndical avec près de trois millions de chômeurs, un million de contrats précaires et trois millions de salariés des petites entreprises, elle a renforcé la montée de couches techniciennes et intellectuelles extérieures à la culture du travail antérieure. Face à cette " déouvriérisation ", à la dualisation du marché du travail, le syndicalisme n'a pas seulement à générer la stratégie appropriée pour faire face, il est en position de missionnaire dont la tâche première consiste à s'introduire dans les zones " barbares ", à comprendre la mentalité des populations à conquérir, à participer à leur vie, à obtenir leur confiance pour finalement les entraîner dans ses rangs. Un travail diversifié est à conduire en direction des chômeurs, des précaires. des jeunes. des femmes, des immigrés, des techniciens, des Intellectuels sans abandonner les professions déjà sensibilisées, sans négliger le socle ouvrier qui assure la production pour tous. (Stephen S. Cohen, John Zysman, Manufacturing Matters. The Llvth of the Post Industrial Economv, New York, Basic Books Inc., 1987, 297 p.) Coordonner les revendications réclame l'élaboration d'objectifs communs prenant appui sur les différents besoins. Une tâche considérable attend donc les militants. Le syndicalisme hexagonal est, d'autre part, incité de manière urgente à développer une action qui réponde aux données de la division internationale du travail. La croissance fordiste du second après-guerre s'effectuait pour une grande part dans un cadre national, selon une logique autocentrée. La construction de la Communauté économique européenne et plus largement le renforcement des firmes multinationales ont rompu l'équilibre antérieur. Désormais, l'économie " ouverte " sur le monde exige des coopérations internationales. Des pratiques se sont esquissées dans le cadre des groupes et des branches. A l'échelle européenne, une concertation intersyndicale se forge lentement. La CFE-CGc a contribué à la constitution de la Confédération européenne des Cadres (CEC). La FEN est active au sein du Secrétariat professionnel international de l'Enseignement (sPIE). La CFDT, Fo, la CFTC sont adhérentes de la Confédération européenne des Syndicats (CES). La demande d'adhésion de la CGT à la CES écartée depuis 1979 se pose en de nouveaux termes avec la disparition de la Fédération syndicale mondiale (Fstvt). Son absence prive la CES d'une composante difficile à ignorer. D'une manière générale, le resserrement des liens internationaux est à l'ordre du jour, même si les problèmes à résoudre sont considérables et ne relèvent pas que de la seule responsabilité du mouvement syndical français. La transformation de la CES en véritable acteur requiert un effort de toutes les organisations qui la composent. Elle pose la question d'une stratégie commune dont la formulation, faible litote, se heurte à des obstacles de taille. .../...En phase de renouvellement, le syndicalisme français reste divisé sur la réponse à apporter à la crise économique. Le modernisme CFDT hésite à reproduire le modèle allemand, qui réclame un patronat apte au compromis et le poids d'un parti social-démocrate fort. Fo se définit par la revendication qui écarte tout projet de société. La CGT recherche à tâtons la refondation d'un syndicalisme de lutte de classe. La démarche de l'albatros corporatif demeure incertaine et maladroite. Rien n'autorise à penser que son affaiblissement est enrayé ni que son recul va se poursuivre. Le retour de la gauche au pouvoir lors de la troisième cohabitation s'accompagne d'une reprise de la vie contractuelle qui reste dissociée d'une véritable mobilisation sociale. Vivant sous le signe de l'incertitude, le mouvement syndical de l'hexagone est face à un avenir difficile et encore indécis, d'autant plus ouvert qu'il saura, selon le conseil d'Antonio Gramsci, conjuguer le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Dans un monde profondément marqué par l'inter- nationalisation, la financiarisation, la flexibilisation, le syndicalisme est placé devant ses responsabilités rassembler, élaborer (débattre-proposer), coordonner.FIN
la FEN / Les jaunes / L'Europe / Conclusion
Du même auteur René MouriauxL'ouvrier Jionçais en 1970 (en collaboration avec Gerard .\da;n ci ul.). Pans. Armand Colin, 1971. Les syndicats ouvriers en France (en collaboration avec Jacques Capdevielic,, Paris, Armand Colin, 1976, 3e éd. L'univers politique et syndical des cadres (en collaboration avec Gérard Grunberg), Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politique,. 1980. Les syndicats européens et la crise (en collaboration avec Klaus Armingc, n et al.), Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1981. Lu parole syndicale (en collaboration avec Alain Bergounioux et al.), Par'.. Presses Universitaires de France, 1982. La CGT, Paris, Editions du Seuil, 1982. Les syndicats dans la .société française, Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 1983. La forteresse enseignante. La Fédération de l'Education nationale (en collaboration avec Véronique Aubert et al.), Paris, Fayard, 1985. Syndicalisme et politique, Paris, Editions Ouvrières, 1985. Le syndicalisme face à la crise, Paris, La Découverte, 1986. Moi 68. L'entre-deux de la modernité (en collaboration avec Jacques Capdevielle), Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politique:,. 1988. La CFDT (en collaboration avec Guy Groux), Paris, Economica, 1989. Petits boulots et grand marché européen (en collaboration avec Jacques Capdevielle et Hélène Y. Meynaud), Paris, Presses de la Fondation national, des Sciences politiques, 1990. Les syndicats européens à l'épreuve (en collaboration avec Geneviève Bibes c r al.), Paris, Presses de la Fondation nationale des Sciences politiques, 19911. La CGT. Crises et alternatives (en collaboration avec Guy Groux), Par;,. Economica, 1992. L e syndicalisme dans le monde, Paris, PUF, coll. " Que sais-je ? ", 1993. Le syndicalisme en France depuis 1945, Paris, La Découverte, 1994. Comment nous ferons la révolution, réédition critique du roman d'Emile Pataud et Emile Pouget (en collaboration avec Pierre Cours-Salies), Syllepse, 1995. Le syndicalisme enseignant en France. PUF, coll. " Que sais-je ? " , 1996. L'unité syndicale en France (coordination avec Pierre Cours-Salies), Syllepr1997. Le souffle de décembre (coordination avec Sophie Béroud), Syllepse, 199-. Les crises du syndicalisme français, Montchrestien, col]. " Clefs ", 1998. L e syndicalisme à mots découverts (en collaboration avec Anne-Marie Hevel et al.), Syllepse, 1998. Le mouvement .social en France (en collaboration avec Sophie Béroud c• Michel Vakaloulis), La Dispute, 1998. L'Année .sociale 1998 (air.), Les Editions de l'Atelier, 1999. 1seN 2 13 044954 9 Dépôt légal - l" édition :1992 -t` édition corrigée : 1999, décembre Presses Universitaires de France, 1992 1(18, boulevard Saint-Germain. 75006 ParisInévitablement sommaires, ces indications bibliographique visent à Fournir au lecteur les références les plus utiles et les plus nourrissante,OUVRAGES GÉNÉRAUX Caire (Guy), Les syndicats ouvriers, Paris, PUE, coll. " Thémis ", 1971 . 602 p. Karila-Cohen (Pierre), Wilfert (Blaise), Leçon d'histoire sur le syndic alisme en France, Paris PuF, coll. " Major " , 1998, 472 p. Launay (Michel), Le Stndicalisme en Europe, Paris, Imprimerie Nationale, 1990, 504 p. Lefranc (Georges). Le mouvement syndical sous la III" République, Paris. Payot, 1967 452 p. Moss (Bernard), Aux origines du mouvement ouvrier français. Le socialisme des ouvriers de métier, 1830 1914, Besançon, Paris, Les Ann,lles littéraires de l'Université de Besançon, Les Belles Lettres, 198 3. 236 p. Mouriaux (René), Les syndicats dans la société française, Paris Pressa de la Fondation nationale des sciences politiques. 1983, 271 p. Reynaud (Jean-Daniel). Les slndicars en France, Paris, Colin. 1`° éd., 1963, 291 p.; 2° éd., 1966, 292 p.; Seuil, coll. " Politique " , 1975, t. 1, 320 p. ; t. 11, 347 p. Robert (Jean-Louis), Boll (Friedhelm), Prost (Antoine), L'invention dl, syndicalismes, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, 333 p.ÉTUDES SUR UNE CONFÉDÉRATION OU UN SYNDICALISME SPÉCIFIQUEAubert (Véronique) et al.. La forteresse enseignante. La Fédération dc l'Education nationale, Paris, Fayard, 1985, 364 p. Bergounioux (Alain), Force ouvrière, Paris, PUE, col]. "Que sais-je ? " , 1982, 128 p. Descostes (Marc), Robert (Jean-Louis), dir., Clefs pour une histoire rlrr svndicalisnre cadre, Paris, Editions Ouvrières, 1984 276 p. Groux x (Guy), Mouriaux (René), La CFDT, Paris, Economica, 198(1. P Groux (Guy), Mouriaux (René), La CGT Crises et alternatives, Paris. Economlca, 1992, 307 p. Le Quentec (Yannick), Employés de bureau et syndicalisme. Paris. L'Harmattan, 1998, 272 p. Siwek-Pouydesseau (Jeanne), Les si ndicats des grands services publics ci l'Europe, Paris, L'Harmattan, 1993, 304 p. 126 \PI'K(r(HI; IIII-\1\ II<jlIS Bcrc~ud ISuPhIe), Mouriaux (René). l',Il\,Ilouli; t\liellcll. Le nruulrnrerrt social cri France, Paris, La Dispute. 1998. 223 p. Ca 23 (Pierre), Les négociations salariales, Paris, Economica, 19,) I . p Devin (Guillaume). dir. Syndicalisme. Dimensions internationales, 1., Garenne-Colombes, Erasme, 1990, 420 p. Lojkine (Jean), Le tabou de la gestion, Paris, Editions de l'Atelier, 1906. 265 p. Mouriaux (René), Syndicalisme et politique, Paris, Editions Ouvrieres, 1985, 214 p. Sa glio (Jean), La régulation de branche dans le système français (le relations professionnelles. Travail et emploi, 1, 1991, n° 47, p. 26-41 ANALYSE DE LA CRISE SYNDICALE Adam (Gérard). Le pouvoir syndical, Paris, Dunod, 1983, 178 p. \madieu (Jean-François), Les syndicats en miettes, Paris, Seuil, 199v, 222 p. I3ihr (Alain), Du grand soir à l' " alternative ". Le mouvement ouvrier , n crise, Paris, Editions Ouvrières, 1991, 298 p. Durand (Jean-Pierre), dir., Le syndicalisme au futur, Paris, Syros, 1996. 365 p. Kergoat (Jacques), Linhart (Danièle), Les transformations du syndica- lisme en France, Problèmes politiques et sociaux, n° 501, avril 199,. 86 p. Labbe (Dominique), Croizat (Maurice). La fin des syndicats ?, Pari,. L'Harmattan 1992 236 p. La Chaise (Guillaume), Crise de l'emploi et fractures politiques, Pans. Presses de Sciences Po 1996 340 p. Mouriaux (René), Crises du .syndicalisme français, Paris, Montchrestien- coll. " Clefs " , 1998, 154 p. Pasture (Patrick), Verberckmoes (Johan), De Witte (Flans), The Losr Perspective ?, Aldershot, Avebury, 1996, t. 1, 284 p. ; t. 11, 408 p. Perrineau (Pascal), éd., L'engagement politique. Déclin ou mutation '. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. 1994. 444 p. Rosanvallon (Pierre), La question syndicale, Paris, Hachette Littérature. 1998, 2° éd.. 273 p. Trier (Pierre-Eric), Mutation ou déclin du syndicalisme ? Le cas de la CFDT, Paris PUF, 1992, 333 p. l ouraine (Alain) et al., Le mouvement ouvrier, Paris, Fayard, 1984. 438 p.
[Accueil] [Lexique] [Liens] [Statistiques] [Archives] [Forum] [Trucs et astuces] [Création de site] cinema
la copie est nécessaire le progrès l'exige.